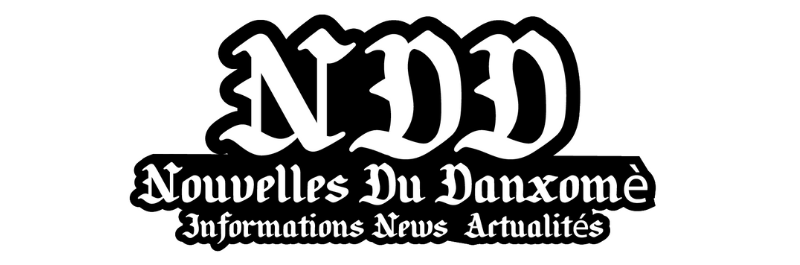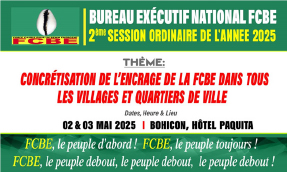Si le cap des 11 millions de contaminations au coronavirus sur le continent a été franchi en février, si celui des 250 000 décès était à son tour atteint début mars, le ralentissement général de la pandémie observé suite à la flambée liée au variant Omicron se confirme de semaine en semaine. Quelques pays comme la Tunisie, la Libye ou le Soudan continuent à afficher des courbes inquiétantes, la partie australe du continent reste globalement plus touchée. Le 12 mai, l’OMS annonçait que le nombre de cas avait progressé de 32 % en une semaine dans la région, tout en soulignant que les contaminations entraînaient toutefois très peu d’hospitalisations, et encore moins de décès. L’heure est donc tout de même à l’accalmie.
Après deux années de pandémie, le bilan devient toutefois assez lourd. Madagascar a atteint en fin d’année dernière le cap symbolique des 1 000 morts du Covid, et le Zimbabwe celui des 5 000. Quant à la Tunisie, elle a eu début mars le triste privilège d’être, après l’Afrique du Sud et le Maroc, le troisième pays du continent à dépasser le million de contaminations. Tandis la Libye franchissait le palier des 500 000. Début avril enfin, l’Afrique du Sud a atteint les 100 000 décès du Covid.
On sait cependant que ces statistiques officielles sont à prendre avec des pincettes : nombre de médecins estimaient depuis longtemps que le nombre de cas était grandement sous-estimé par les statistiques officielles, et l’OMS a jeté un véritable pavé dans la mare en annonçant mi-octobre 2021 que le bilan réel était sans doute sept fois supérieur à ce qui est annoncé, soit à cette date environ 59 millions de cas sur le continent (et un nombre de décès a priori supérieur également, mais pas dans les mêmes proportions). En cause, principalement : le très grand nombre de malades totalement asymptomatiques. Ce qui ne les empêche malheureusement pas d’être contagieux.
La nouveauté dans ce domaine vient d’une étude publiée début mars par le Lancet, selon laquelle la sous-estimation systématique du nombre de cas ne serait pas un problème africain, mais mondial. Selon le magazine scientifique de référence, le bilan de la pandémie serait environ trois fois supérieur à ce qui est annoncé, avec non pas 5,9 millions de décès enregistrés entre début 2020 et fin 2021 mais… 18,2 millions ! Toujours selon les scientifiques, les pays dans lesquels l’écart entre chiffres officiels et mortalité réelle est le plus important seraient, par ordre décroissant, l’Inde, les États-Unis, la Russie, le Mexique, le Brésil, l’Indonésie et le Pakistan.
En avril toujours, le bureau Afrique de l’OMS a estimé que le véritable bilan était sans doute encore plus élevé que ces différentes évaluations le laissaient entendre. Selon sa directrice générale, Matshidiso Moeti, ce seraient en fait 65 % de la population africaine qui aurait été infectée au Covid-19 depuis 2020. Un chiffre 97 fois plus élevé que les statistiques officielles qui ne peut qu’étonner. mais qui, encore une fois, s’expliquerait par le fait que dans la grande majorité des cas (les deux tiers, selon l’OMS), les Africains contaminés n’auraient développé aucun symptôme.
Des capacités de séquençage très insuffisantes
Quant aux mesures de riposte mises en place face au virus, on sait maintenant que la lutte contre la pandémie passe par une meilleure identification des variants qui sévissent au sein de chaque communauté, ce qui suppose de procéder à beaucoup plus de séquençages des échantillons prélevés sur les malades. Les capacités techniques permettant de procéder à cette opération sont malheureusement très insuffisantes dans la plupart des pays. L’Afrique ne représente à ce jour que 1 % des opérations de séquençage du Covid réalisées dans le monde. L’OMS a rappelé début décembre que chaque pays du continent devait se fixer pour objectif de réaliser au minimum 75 à 150 analyses par semaine. Certains en sont très loin.
Sur le plan de la vaccination, le bilan reste décevant, même si les chiffres progressent et que la perspective de produire prochainement des sérums en Afrique même, au moins sous licence, semble de moins en moins utopique. Fin mars, 16 % seulement de la population du continent est entièrement vaccinée. Le rythme des livraisons de doses, en particulier grâce au dispositif Covax, est cependant en augmentation : 816 millions ont été réceptionnées au total (mais seulement 450 à 480 millions effectivement administrés).
« Le monde a enfin entendu nos appels. L’Afrique a désormais accès aux vaccins qu’elle réclamait depuis trop longtemps », a estimé le 3 février la Directrice régionale de l’OMS, Matshidiso Moeti. Mais le rythme est encore bien trop lent : actuellement, six millions de personnes sont vaccinées en moyenne chaque semaine en Afrique. Il faudrait passer à 36 millions par semaine pour atteindre l’objectif de 70 % de couverture vaccinale, tel que convenu au niveau mondial.
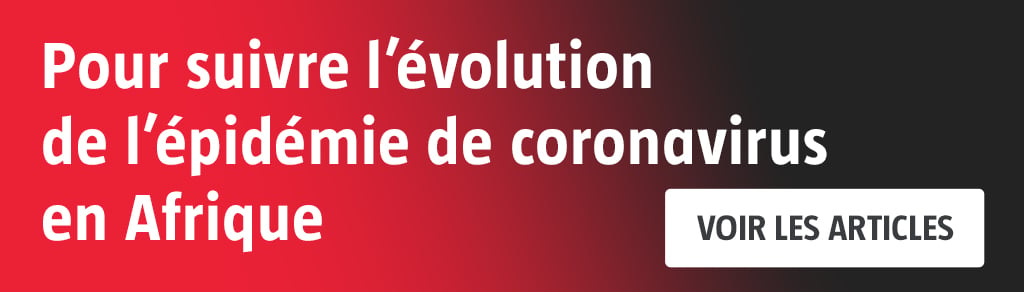
Mise à jour régulièrement, notre carte évolutive dresse un panorama en temps réel de l’état d’avancée de la maladie. Elle se concentre sur trois variables : le nombre de décès, le nombre total de cas déclarés depuis le début de l’épidémie, et le nombre de guérisons recensées (que beaucoup de pays ont toutefois tendance à actualiser de moins en moins régulièrement). En passant votre souris sur chaque pays, vous pourrez consulter le détail de ces informations par pays, mais aussi les différentes mesures de restriction mises en place.
La couleur de la carte est graduée selon le nombre de décès.
Si vous ne parvenez pas à lire la carte : cliquez ici.