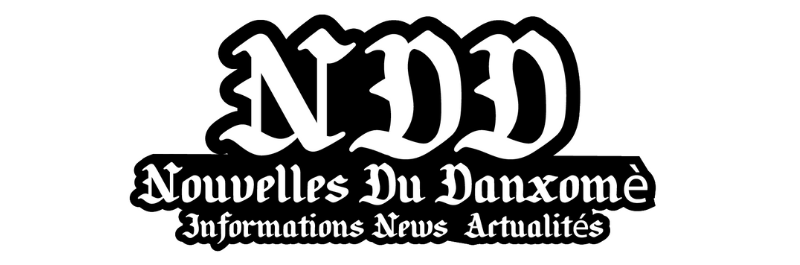Le secteur pharmaceutique occupe une place stratégique dans les politiques de développement des nations modernes. Au-delà de sa mission première de préservation de la santé publique, il joue un rôle moteur dans l’économie, en stimulant l’innovation, en créant des emplois qualifiés et en réduisant la dépendance extérieure. Il représente aussi un enjeu de souveraineté nationale, particulièrement dans les contextes de crises sanitaires mondiales ou régionales.
Pour les pays africains, renforcer cette filière signifie aussi bâtir une sécurité sanitaire durable et favoriser une meilleure accessibilité aux traitements pour leurs populations. Dès lors, les investissements dans l’industrie pharmaceutique ne relèvent pas uniquement d’une logique industrielle, mais traduisent une volonté politique forte d’asseoir une autonomie stratégique.
En Algérie, cette dynamique est portée par une volonté manifeste de faire du pays un pôle pharmaceutique régional. L’État y consacre une attention prioritaire, notamment à travers l’augmentation significative de la couverture locale en médicaments, qui atteint aujourd’hui 79 %. Cette performance permet de réduire sensiblement la facture des importations tout en renforçant la résilience du système de santé. Sur les 600 unités industrielles opérant sur le continent africain, l’Algérie en héberge 218, concentrant à elle seule près de 30 % du tissu industriel pharmaceutique africain. Ce positionnement témoigne d’une stratégie industrielle structurée, à laquelle s’ajoute une ambition exportatrice de plus en plus affirmée.
Malgré cette avancée, des défis demeurent, notamment dans le domaine des dispositifs médicaux. Le pays continue d’importer près de 98 % de ses équipements, générant un coût annuel d’environ 630 millions de dollars. Consciente de cette dépendance, l’Algérie projette de produire localement 30 % de ces équipements avec une qualité apte à l’exportation, encourageant au passage les investissements privés à s’impliquer dans cette chaîne de valeur.
Parallèlement, l’Algérie investit dans des segments de pointe tels que la thérapie cellulaire et la production de matières premières pharmaceutiques. À Sétif et Constantine, deux unités destinées à la fabrication locale de principes actifs sont en cours d’installation, avec un accent particulier sur les traitements anticancéreux. Une coopération avec l’Institut Karolinska en Suède est également engagée pour la création d’une unité de thérapie cellulaire, en partenariat avec le groupe public Saïdal, qui pourrait ainsi devenir une référence continentale dans ce domaine de la médecine de précision.
Au sud du pays, un projet industriel est à l’étude dans la wilaya de Tamanrasset, avec pour objectif de produire des médicaments ciblant les maladies tropicales. L’initiative permettra une meilleure réactivité face aux épidémies et contribuera à l’amélioration des soins dans les régions souvent sous-équipées.
Alors que certaines entreprises algériennes débutent déjà des opérations d’exportation de stylos à insuline, la question de l’accès aux marchés africains se précise. Une évaluation par l’Organisation mondiale de la santé, prévue pour septembre 2025, pourrait ouvrir à l’Algérie l’accès au niveau 3 de réglementation, condition essentielle pour exporter vers plusieurs pays du continent. Ce jalon réglementaire marquerait un tournant dans la capacité de l’Algérie à proposer des solutions de santé compétitives à l’échelle africaine.
L’Algérie entend désormais se positionner comme un fournisseur de soins, au-delà de ses frontières. Entre volonté politique, innovation thérapeutique et renforcement des capacités industrielles, le pays esquisse les contours d’une nouvelle souveraineté pharmaceutique.