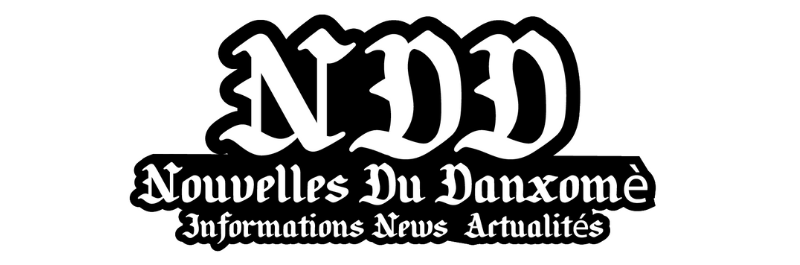Face aux conflits récurrents autour des exploitations agricoles, la sécurisation foncière demeure un enjeu majeur pour sécuriser les investissements.
« Si probablement la cause de la troisième guerre mondiale sera l’eau, ici il pourrait y avoir des conflits régionaux liés à la gestion du foncier si l’on n’y prend pas garde », alerte Gaston C. Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. « La mauvaise gestion du patrimoine foncier pourrait entraîner le désordre et empêcher de produire », a-t-il insisté, le 18 mai dernier, à l’ouverture d’un atelier sur les trajectoires des politiques foncières au Bénin.
En fait, la terre nourricière reste un bien déterminant pour les sociétés humaines en général et dans la vie des producteurs, éleveurs, pisciculteurs, exploitants forestiers en particulier, relève Lawani Arouna, président de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin (Pnoppa-Bénin). En cela, indique-t-il, les terres sont essentielles pour la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, la stabilité sociale et la sécurité du logement.
La réforme foncière dont l’aboutissement a été la promulgation de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n° 2017-15 du 10 août 2017, vise l’accès équitable et inclusif au foncier, la sécurisation des investissements, la gestion efficace des conflits fonciers afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un développement intégré et durable. Nonobstant cette législation, les acteurs du monde rural éprouvent au quotidien des difficultés relatives à leurs activités, malgré les dispositions contenues dans ledit code qui devraient limiter les spéculations et sécuriser les investissements.
A chacun son espace
La sécurisation foncière des exploitations agricoles, à travers l’obtention des attestations de détention coutumière (Adc) demeure un enjeu de taille en raison de l’inexistence ou du non-fonctionnement des instances locales de gestion foncière dans certaines localités rurales, relève M. Arouna. De même, le pari est loin d’être gagné en termes de respect des droits d’accès à la terre des femmes, ajoute-t-il.
Pour le ministre de l’Agriculture, les éleveurs et les agriculteurs doivent avoir leurs espaces pour mener leurs activités économiques en toute quiétude. « Si ce n’est pas clairement défini et que les gens s’acceptent, le développement serait conjugué au futur », estime-t-il.
La délimitation des espaces, des couloirs de passage des animaux reste aussi une préoccupation pour les acteurs. En dépit des efforts consentis ces dernières années avec à la clé l’adoption de la loi n° 2018-20 du 23 avril 2019 portant Code pastoral, les conflits entre paysans et éleveurs transhumants sont toujours d’actualité.
Les décrets d’application de ce code se font toujours attendre. Son opérationnalisation nécessite également des cadres d’échanges et de réflexion entre les différents acteurs pour la bonne réalisation des objectifs.
Mais au-delà, ce qui taraude les esprits, c’est « l’urbanisation galopante », avec les lotissements à tout-va. « A l’avènement de la décentralisation, on a commencé à tirer la chaîne d’arpenteur, au point qu’aujourd’hui il est difficile de trouver d’espaces dans les villes et même dans certaines régions pour implémenter des projets d’envergure », se désole le ministre.
Il pointe aussi du doigt l’appropriation tous azimuts des vallées, collines et autres ressources naturelles comme des biens privés ainsi que la stigmatisation de certaines catégories de producteurs et ce, malgré l’existence des textes. « Ainsi, nous poussons nos propres frères dans les bras des djihadistes et ils reviendront nous charcuter », avertit Gaston Dossouhoui, évoquant les enjeux et les dynamiques sociales dans le processus de mise en œuvre de la politique foncière du Bénin.
Eviter le pire
Face à cette question sécuritaire, il urge de trouver les voies et moyens pour prévenir le pire. « Si tout doit être réglementé par les textes pour une meilleure gestion des espaces et leur préservation pour les générations à venir, les modes de production doivent également bouger », préconise le ministre de l’Agriculture.
Par ailleurs, il plaide pour la sédentarisation des troupeaux à travers la production du fourrage et la maîtrise de l’eau, toutes choses qui permettront de limiter les conflits qui naissent entre agriculteurs et éleveurs du fait de l’élevage divaguant. C’est en ce sens que le Projet de sédentarisation des troupeaux (Proser) lancé en décembre 2021 pour une durée de cinq ans, requiert toute son importance. D’un coût global de 35 milliards F Cfa, il permettra d’amorcer une transformation profonde du système d’élevage des ruminants, notamment la sécurisation des espaces pastoraux, l’amélioration de la productivité et la production du bétail, la lutte contre la pauvreté, la création de la richesse additionnelle et surtout la réduction des conflits liés à la transhumance. Aussi, les regards sont-ils tournés vers le Projet d’appui au développement des filières lait et viande et à la promotion des entreprises d’élevage (Prodefilav-Pel 2022-2026) qui prévoit, entre autres, l’aménagement de 2 500 hectares d’aires de pâturage et le balisage de 500 km de couloirs de passage des animaux, la réalisation ou la réhabilitation de systèmes d’alimentation en eau.