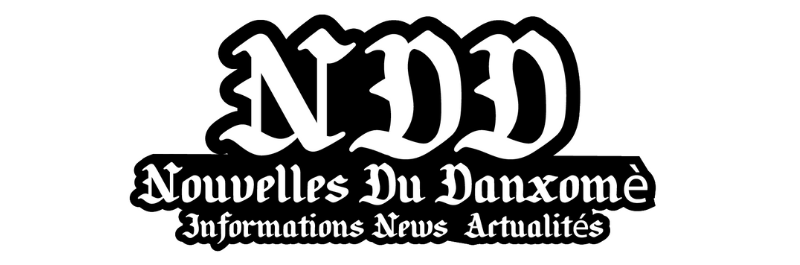Les risques budgétaires sont globalement maîtrisés en vue de l’atteinte des prévisions contenues dans le projet de loi de finances 2023. Des mesures d’atténuation sont préconisées pour le suivi et la gestion des menaces pouvant affecter les recettes et les dépenses publiques.
« Les risques budgétaires sont globalement maîtrisés au Bénin et le gouvernement maintient un état de veille permanent pour actualiser la liste des risques si nécessaire et déclencher à temps les dispositifs de gestion des risques budgétaires en vue de limiter les impacts à un niveau minimum ». C’est la conclusion du document d’Analyse des risques budgétaires adossé au projet de loi de finances gestion 2023 transmis à l’Assemblée nationale.
Ainsi, les facteurs pouvant entraîner un écart entre les prévisions de recettes et/ou de dépenses et leur réalisation effective au cours de l’exercice seront contenus, grâce aux réformes engagées pour assainir et moderniser les finances publiques d’une part, et renforcer la confiance des investisseurs d’autre part. A cet effet, un Comité national de suivi des risques budgétaires a été créé cette année et coordonne les activités relatives à l’analyse des risques. Il passe au peigne fin les chocs potentiels sur les recettes, les dépenses, les actifs ou les passifs de l’État qui pourraient ne pas être traduits dans les prévisions. Autrement, l’avènement de ces risques entraînerait des dépenses additionnelles, une augmentation de la dette publique ainsi que des difficultés de refinancement ou une diminution du niveau des recettes budgétaires.
La mise en place de ce comité fait suite à l’évaluation de la Transparence des finances publiques (Fte) du Fonds monétaire international (Fmi) en juillet 2021, laquelle a conduit à l’adoption et à l’implémentation du nouvel outil d’analyse des risques budgétaires. Il s’agit du Fiscal Risk Assessment Tool (Frat) du Fmi qui dote la direction générale de l’Economie (Dge/Mef) de capacités substantielles dans l’appréciation des risques budgétaires. Aussi, un document de cartographie des risques budgétaires est-il élaboré.
A l’analyse, certains risques budgétaires s’avèrent peu probables tandis que d’autres présentent un niveau de pertinence élevé au regard du contexte socio-économique. Entre autres, l’écart entre le taux de croissance effectif et le taux de croissance anticipé du produit intérieur brut (Pib) est un risque macroéconomique potentiel qui pourrait déstabiliser l’équilibre budgétaire, tout comme le risque de perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales.
Flux et effets
Les risques liés au cours des matières premières sont aussi importants, l’économie béninoise étant particulièrement tributaire de l’évolution des cours du coton et du pétrole sur le marché international. Les prévisions de la Banque mondiale pour l’année 2023 sont peu optimistes pour le coton, tablant sur un cours annuel d’environ 2,9 $/kg contre 3,1 $/kg en 2022.
Quant au risque lié à la fluctuation des cours du pétrole, il est considéré comme moyen. La Banque mondiale table sur un prix du baril de pétrole de 92,0 dollars en 2023 contre 100,0 dollars en 2022, soit une baisse de 8 %.
Les risques liés à un éventuel ralentissement des échanges avec des partenaires clés focalisent aussi l’attention. Le cas du Nigeria, principal partenaire commercial du Bénin, est à prendre en considération au regard de l’étroitesse des relations commerciales entre les deux pays. Pour rappel, le Nigeria a absorbé 66,08 % des exportations totales (entre 2015 et 2020, selon la Bceao), et y a convoyé 18,83 % des importations nationales sur la même période.
La dernière fermeture des frontières du géant voisin de l’Est survenue de façon unilatérale en août 2019 et qui a duré plusieurs mois, a considérablement affecté l’économie béninoise quoiqu’elle ait fait preuve de résilience. Ce n’était pas un cas isolé dans l’histoire, puisque d’autres fermetures sont intervenues d’avril 1984 à décembre 1985, puis en 1996, 2003, 2013. La probabilité de survenance de ce risque d’origine essentiellement politique est estimée à 30 % par la Dge, et entraînerait le ralentissement des flux commerciaux entre les deux pays.
Le risque de taux de change est non négligeable au regard non seulement du volume des transactions en naira et en dollar, mais aussi de la dette extérieure du Bénin libellée en devises étrangères : 66,8 % en euro et 16,87 % en dollar au 31 mars 2022, d’après les services du ministère de l’Economie et des Finances. La probabilité d’occurrence du risque de dépréciation de la monnaie nigériane est de 20 % et celle entre le dollar et le franc Cfa de 30 %, évalue la Dge. Le cours du dollar ne fait que grimper depuis plusieurs mois.
Mitigation
En plus de la variation du taux de change, d’autres risques sont associés à la dette publique à savoir le risque de variabilité du coût de la dette, le risque de taux d’intérêt, le risque de refinancement qui sont peu probables ou faibles. Avec un taux d’endettement public affiché à
50,02 % à fin juin 2022, le Bénin dispose encore d’une marge d’endettement d’environ 20 % du Pib, suivant le critère de convergence relatif au seuil de 70 % fixé pour les pays membres de la zone Uemoa.
Une éventuelle faillite des institutions financières (banques, systèmes financiers décentralisés) est une source de risques qui nécessiteraient l’assistance de l’Etat pour combler le besoin de renflouement. Ces risques financiers qui pourraient obérer les charges financières de l’État sont quelque peu maîtrisés, grâce à la consolidation du système bancaire et aux réformes visant à améliorer les performances dans le secteur de la microfinance.
De même, la probabilité de survenance du risque lié au secteur des assurances reste faible, au regard de la rareté des facteurs pouvant remettre en cause l’efficacité du système de contrôle.
Pour atténuer les risques liés aux produits bruts exportés, l’Etat béninois a opté pour une politique de prix qui protège les producteurs locaux des principales cultures d’exportation, en fixant au début de chaque saison agricole les prix d’achat. Le risque de baisse des recettes d’exportations peut être mitigé par la consolidation de la politique de diversification de l’économie et surtout par l’accélération de l’installation d’infrastructures de transformation locale du coton et des autres produits agricoles d’exportation à l’instar des initiatives en cours de réalisation dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz).
D’autres risques sont identifiés mais restent en général faibles. Il s’agit du risque de crédit lié à la perception du marché, du risque de liquidité, du risque lié à la viabilité de la dette, de la garantie souveraine délivrée par l’Etat. En revanche, les risques de catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, épidémies) sont immanents et la probabilité de leur survenance reste moyenne, au regard des événements survenus ces dernières années. Cela appelle à des actions d’anticipation et des stratégies d’atténuation. Il apparaît opportun de renforcer davantage le dispositif institutionnel de surveillance des risques budgétaires. L’examen des flux fiscaux et des transactions entre le gouvernement et les entreprises des secteurs public et privé est aussi de mise?