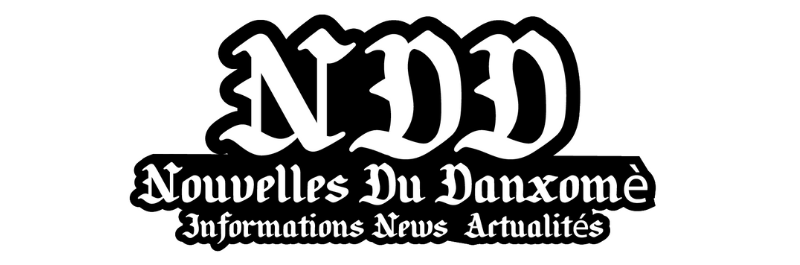Chiffré à 41,4 % en 2021 contre 42,5 % en 2020, le taux d’autosuffisance en produits de pêche et d’aquaculture reste à améliorer au Bénin. Et pour cause, la production halieutique est en baisse depuis deux ans, avec pour effet direct une augmentation du taux de dépendance des importations de produits congelés.
La production halieutique est évaluée à 76 925 tonnes en 2021 contre 82 417 tonnes en 2020 au Bénin, soit une baisse de 6,7 %, d’après les données de la direction de la Statistique agricole du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (Dsa/Maep). Pendant ce temps, l’importation des produits congelés s’élève à 105 817 tonnes en 2021 contre 106 187 tonnes un an plus tôt. Ainsi, le taux d’autosuffisance en produit de pêche et d’aquaculture a chuté de 42,5 % en 2020 à 41,4 % en 2021, ce qui traduit une augmentation de la dépendance aux importations de poissons. La chute de la production nationale est essentiellement liée au repli observé au niveau de la pêche continentale. Celle-ci a enregistré en 2021 une baisse de 18,1 % avec une production de 36 631 tonnes contre 44 726 tonnes en 2020, alors que la moyenne des cinq dernières années est établie à 40 271 tonnes avec un pic à 45 762 tonnes en 2019. Le poids de la pêche continentale qui était en moyenne de 56,6 % dans la production totale halieutique a chuté pour s’établir à 47,6 % en 2021. De même, la pêche maritime industrielle a connu une chute vertigineuse de sa production en passant de 218 tonnes en 2020 à seulement 53 tonnes en 2021, contre une moyenne de 152 tonnes sur les cinq dernières années (221 tonnes en 2019). Cette baisse représente respectivement 75,5 % et 64,9 % par rapport à 2020 et à la moyenne des cinq dernières années. En revanche, les captures de la production maritime artisanale sont en hausse, sans toutefois atteindre le niveau de 37 948 tonnes de 2019. Elles sont estimées à 37 591 tonnes en 2021 contre 34 443 tonnes en 2020, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à 2020 et de 42,1 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années établie à 26 451 tonnes.
Causes
Estimée à 2 649 tonnes contre 3 031 tonnes en 2020, la production totale aquacole a connu une baisse de 12,6 %. Par rapport à la moyenne estimée à 4 440 tonnes sur les cinq dernières années, la chute s’élève à 40,3 %. La baisse notée au niveau de la pêche continentale peut être due aux actions de la brigade de surveillance des plans et cours d’eau qui consistent à la répression, notamment la saisie des engins de pêche prohibés occasionnant la surexploitation des ressources halieutiques, suppose la Dsa. En ce qui concerne la pêche maritime industrielle, les conditions d’exercice de l’activité se sont dégradées au cours de l’année 2021 à cause de la psychose des actes de piraterie dans le golfe de Guinée. En effet, la Multinational Maritime Center a décelé en 2021 un incident dans les eaux sous juridiction du Bénin. Cette situation a dissuadé les autres navires détenteurs de licence à pratiquer pleinement les activités de pêche dans les eaux béninoises. Quant à la production aquacole, la baisse est due aux difficultés d’importation de l’aliment extrudé adopté par les pisciculteurs en raison de la pandémie de Covid-19 qui a engendré des perturbations au niveau des transports et la cherté des produits. Avant la crise sanitaire, la production halieutique nationale a atteint 89 249 tonnes en 2019 dont 5 318 tonnes pour l’aquaculture continentale.
Promac, l’espoir !
Le Bénin compte renforcer la production de ressources halieutiques en vue d’assurer la sécurité alimentaire. C’est dans ce cadre que s’inscrit le Projet de promotion de l’aquaculture durable et de compétitivité des chaines de valeur de la pêche (Promac) visant à accroître la contribution du secteur aux économies locales et nationale. D’envergure nationale, il sera déployé, sous l’égide du Maep, jusqu’en 2026 au niveau de la façade maritime, des plans et cours d’eau continentaux, des bas-fonds, des forages artésiens et des plaines inondables. Le projet contribuera à ériger cinq écloseries de tilapia, clarias et d’autres espèces pour une capacité de production de 60 millions d’alevins par an et cinq fabriques d’aliments pour une capacité totale de 20 000 tonnes/an. Il appuiera la construction et l’équipement de 500 ha d’étangs et 75 000 m3 de cages et d’enclos. Les activités de formation technique et entrepreneuriale seront organisées à l’intention de 6 000 pisciculteurs, 200 agents techniques de vulgarisation dont 50 % de femmes. Deux plans de gestion des pêcheries seront mis en œuvre. Un point de débarquement aménagé (Pda) sera érigé à Grand-Popo. La capacité opérationnelle de la Brigade de Surveillance et de Contrôle des plans d’eau sera renforcée. Par ailleurs, le projet participera à la mise en place de 21 réserves biologiques en milieu continental et régional à travers le golfe de Guinéen C. U. P.