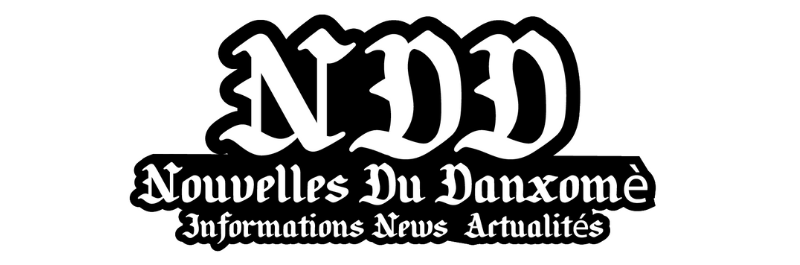Le potentiel fiscal du Bénin reste faible (de l’ordre de 6 % du Pib contre 20 % prescrit dans l’Uemoa), selon une étude menée sur la période 1989-2019. Des mesures coercitives permettront d’asseoir durablement un civisme fiscal et de favoriser la collecte des ressources domestiques.
Le Bénin n’a collecté les recettes fiscales qu’à hauteur de 66,15 % de ses capacités sur la période 1989-2019, selon l’Examen du potentiel fiscal du Bénin. L’effort fiscal moyen qui représente la performance ou l’efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales, a été de 63,57 % en moyenne sur les cinq dernières années de l’étude (2015-2019), précise le « document de travail » signé par Moïse Lawin, publié par le ministère de l’Economie et des Finances. Cela met en évidence une possibilité de mobilisation fiscale supplémentaire de 36,43 %, indique l’auteur de l’étude.
Le potentiel fiscal (recettes additionnelles pouvant être collectées) est de l’ordre de 5,83 % du produit intérieur brut (Pib) en moyenne sur la période 1989-2019 et 5,76 % en moyenne sur la période 2015-2019, suivant les estimations issues de la base de données de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao). La situation du Bénin a révélé une sous-mobilisation des recettes fiscales et une transition fiscale inachevée. Les recettes totales collectées se sont établies à 13 % du Pib en 2016, 13,2 % en 2017 (Banque mondiale, 2018), 15,7 % en 2018 selon l’édition 2019 de Bilan et perspectives à court et à moyen termes de l’économie nationale (Bipen). La Banque mondiale a indiqué que la pression fiscale est restée comprise entre 14,9 % et 13,2 % du Pib, entre 2010 et 2017, dénotant ainsi une inefficacité des politiques de mobilisation des ressources.
Secteur informel prépondérant
Ce faible niveau de collecte des recettes fiscales se justifie, entre autres, par la prépondérance du secteur informel, des problèmes de gouvernance et de corruption. En effet, l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (Eri-Esi 2018) a révélé que le secteur informel reste prédominant, ce qui laisse échapper une grande partie des recettes que devrait engranger l’Etat au titre des impôts et taxes.
L’analyse par type d’impôts révèle que sur la période de l’étude, le potentiel fiscal relatif aux impôts directs est de 3,36 % du Pib, et de 3,01 % du Pib en moyenne sur la période 2015-2019. De même, les résultats ont révélé que le potentiel fiscal relatif aux impôts sur le commerce extérieur est de 1,06 % du Pib, et de 0,5 % du Pib en moyenne sur les cinq dernières années de l’étude.
L’évolution des recettes totales laisse apparaître globalement une tendance haussière sur la période 1989- 2019. De 34,4 milliards F Cfa en 1989, elles se sont établies à 713,09 4 milliards F Cfa en 2015, soit un taux de croissance annuel de 12,36 % sur la période 1989-2015. Puis, elles affichent une baisse de 71,99 milliards F Cfa en 2016, soit une régression de 11,23 % en raison de la baisse des impôts et des recettes douanières collectés au cours de ladite année. La période 2017-2019 a été marquée par une amélioration des recettes qui, de 641,1 milliards F Cfa en 2016, se sont établies à 712,82 milliards F Cfa en 2017, puis à 811,3 milliards de francs Cfa en 2018 et à 935,6 milliards F Cfa en 2019, soit un taux de croissance de 11,18 %, 13,81 % et 15,32, respectivement en 2017, 2018 et 2019. Pour l’analyste M. Lawin, cela traduit l’efficacité des politiques de mobilisation des ressources fiscales.
Mesures
La pression fiscale (les recettes fiscales rapportées au Pib) a globalement suivi la même tendance, passant de 5,4 % du Pib à 16 % du Pib entre 1990 et 2008, avec un creux de 14 % en 2006. Elle a chuté par la suite à 9,1 % du Pib en 2016, avant de s’accroître depuis 2016 : 10,6 % du Pib en 2019.
Mais les niveaux atteints restent en deçà de la moyenne des pays de l’Afrique sub-saharienne et largement en dessous de la barre des 20 % du Pib, seuil fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) comme critère de convergence macroéconomique.
Par ailleurs, l’étude montre que les secteurs non agricoles sont fortement fiscalisés au Bénin par rapport au secteur agricole. De 8,8 % en 1990, la pression fiscale hors secteur agricole s’est établie à 15,2 %
en 1998, puis à 16 % en 2008, son niveau le plus élevé. Elle est retombée à 12,2 % en 2016 avant de s’établir à 14,7 % en 2019. Une politique visant la transformation structurelle de l’économie béninoise pourra permettre de rattraper le potentiel perdu, préconise l’étude.
Pour améliorer efficacement l’effort fiscal et rattraper le potentiel perdu, estime l’auteur, l’Etat pourra envisager une politique d’élargissement des assiettes fiscales directes à travers une accélération des procédures de formalisation des entreprises. A l’en croire, la mise en place de mesures coercitives, en cas de fraude fiscale, permettra d’améliorer les recettes fiscales. L’Etat pourra également intensifier les actions de communication afin de démystifier la matière fiscale, de chasser la peur de l’impôt et d’asseoir durablement un civisme fiscal, indispensable à la collecte des ressources domestiques, ajoute-t-il.