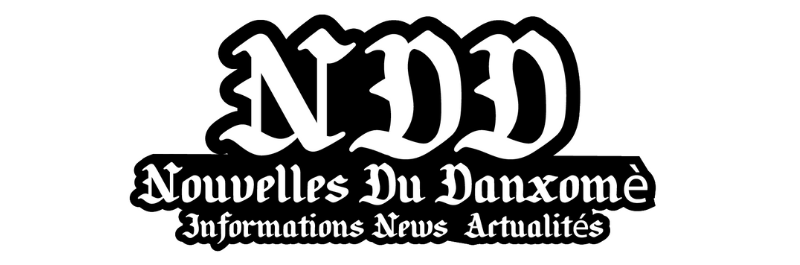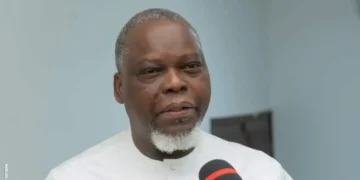Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue dans cette nouvelle édition du Brief de JA, une newsletter qui revient pour vous, chaque semaine, sur les articles qu’il ne fallait pas manquer.
Au programme de cette édition :
1 – Mali : vers un renforcement des pouvoirs d’Assimi Goïta
2 – RDC : la solution Trump suscite autant d’espoir que de méfiance à Kinshasa
3 – Côte d’Ivoire : tout comprendre au débat sur l’inéligibilité de Tidjane Thiam
4 – BAD : cinq candidats mais un seul véritable programme ?
5 – Au Maroc, bras de fer entre les ONG et le ministre de la Justice
la suite après cette publicité
__________
1 – Mali : vers un renforcement des pouvoirs d’Assimi Goïta
Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, lors de son arrivée à l’aéroport de Pulkovo, avant le deuxième sommet Russie-Afrique, à Saint-Pétersbourg, le 26 juillet 2023. © Peter KOVALEV / TASS Host Photo Agency / AFP
Fin annoncée des partis politiques. Ce qu’il reste de la classe politique malienne sentait le coup venir. Le couperet n’est pas encore définitivement tombé, mais ses craintes semblent bien sur le point de se réaliser. Mardi 29 avril, les « concertations nationales », lors desquelles aucun opposant à la junte n’était présent, ont livré une série de « recommandations ».
Parmi celles-ci, la dissolution de tous les partis politiques, et le renforcement des règles permettant d’en créer de nouveaux. Dès le lendemain, à l’issue d’un Conseil des ministres présidé par Assimi Goïta, les autorités de la transition malienne ont annoncé l’abrogation de la charte des partis politiques, un texte de 2015 régissant les règles juridiques et éthiques auxquels ils doivent se conformer. « L’abrogation de cette loi ne met pas en cause l’existence des formations politiques », a assuré le directeur général de l’Administration du territoire, Abdou Salam Diepkile.
Il n’en reste pas moins que plus aucune disposition légale n’encadre l’existence des partis politiques maliens. Il faudra attendre que le projet de loi porté par la junte soit présenté devant le Conseil national de transition (CNT, organe législatif) pour en savoir plus. Le CNT faisant figure de chambre d’enregistrement, la dissolution des partis politiques maliens ne semble donc qu’une question de jours.
Président pour cinq ans, au moins. Autre « recommandation » formulée lors des concertations organisées par la junte : la désignation du général Assimi Goïta au poste de « président de la République pour un mandat de cinq ans à partir de 2025 ». Mandat qui serait « renouvelable », sans qu’une limitation ne soit précisée. Sur ce point, le Conseil des ministres n’a pas statué formellement mais relève qu’un tel changement permettrait à Assimi Goïta d’avoir un statut similaire à celui de « ses pairs de l’AES ».
À l’instar des dispositions relatives aux partis politiques, ce changement de statut suppose une nouvelle révision de la charte de la transition. Le texte, promulgué en septembre 2020, au lendemain du coup d’État contre Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), prévoyait une transition d’une durée de vingt-quatre mois. Un nouveau texte avait été promulgué en 2022. La durée de la transition n’avait alors pas été inscrite dans le texte, qui renvoyait aux conclusions des assises nationales qui s’étaient tenues en amont, évoquant une durée comprise entre « six mois et cinq ans ».
Guerre des clans. Cette phase de renforcement des pouvoirs d’Assimi Goïta intervient alors que la junte malienne est en proie à des dissensions internes entre les artisans du putsch fomenté contre IBK. Dans les premiers mois qui ont suivi le coup d’État, les « cinq colonels » – Assimi Goïta, Ismaël Wagué, Malick Diaw, Modibo Koné et Sadio Camara – veillaient à afficher leur unité en toute occasion. « Aujourd’hui, ils ne se réunissent plus que rarement. Et c’est Goïta qui prend toutes les décisions », confie un acteur politique basé à Bamako à Jeune Afrique, dans l’article que nous consacrons à cette « guerre des clans ».
Cette lutte discrète oppose Assimi Goïta à Sadio Camara, ministre de la Défense. Le premier peut notamment compter sur Modibo Koné, le patron des services de renseignement, et Abdoulaye Maïga, qui a succédé à Choguel Kokalla Maïga à la primature. Le second a le soutien d’Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation nationale, et de Malick Diaw, président du CNT.
2 – Est de la RDC : la solution Trump suscite autant d’espoir que de méfiance à Kinshasa

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio (centre), la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner (gauche), et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe (droite), le 25 avril 2025. © Andrew Leyden /NurPhoto via AFP
Un pré-accord encore flou. L’administration Trump a annoncé, vendredi 25 avril, avoir obtenu la signature d’une déclaration commune entre la RDC et le Rwanda, Kigali et Kinshasa s’affirmant prêts à « créer un avant-projet d’accord de paix ». C’est le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, qui a mené cette médiation entre Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe.
Sur le plan symbolique, c’est un pas diplomatique indéniable. D’autant que, le 23 avril, les autorités congolaises et le M23, en pourparlers au Qatar, ont publié pour la première fois une déclaration commune affirmant leur volonté commune d’« œuvrer à la conclusion d’une trêve ».
Concrètement, l’accord demeure cependant encore flou. Il repose sur six engagements : non-ingérence mutuelle, résolution des différends par la voie diplomatique, ou encore « reconnaissance des préoccupations sécuritaires légitimes de part et d’autre ».
Espoirs et méfiances. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a salué un « pas dans la bonne direction ». « Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n’y aura plus de problème d’instabilité en République démocratique du Congo », a-t-il déclaré en marge d’une conférence de presse commune avec son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló.
Un avis qui est loin de faire l’unanimité à Kinshasa. « Notre pays, la RDC, est confronté à une menace existentielle sans précédent », s’inquiètent une quarantaine de personnalités de la société civile, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, dans une lettre ouverte rendue publique le 1er mai. Ils y émettent aussi leurs « réserves » sur la déclaration de principes du 25 avril, dont ils critiquent « l’esprit transactionnel » et dont ils dénoncent « l’opacité », en particulier sur le volet des « minerais stratégiques ».
3 – Côte d’Ivoire : tout comprendre au débat sur l’inéligibilité de Tidjane Thiam

Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale le 22 avril, à quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre. © Sia KAMBOU / AFP
Interprétations. Le 22 avril, Tidjane Thiam, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a été radié des listes électorales. Une décision non susceptible de recours, qui entraîne mécaniquement l’inéligibilité de ce dernier.
Cette décision de justice, qui rebat les cartes de la présidentielle à quelques mois du scrutin d’octobre prochain, est l’objet de toutes les interprétations. Que stipule précisément l’ordonnance de quarante pages qui fonde la décision des juges ivoiriens ? Comment le PDCI tente-t-il de sauver son candidat ? Comment le pouvoir gère-t-il la montée des tensions que cette radiation provoque ? Aïssatou Diallo, correspondante de Jeune Afrique à Abidjan, démêle le vrai du faux dans cette affaire hautement complexe.
Secrets d’une affaire d’État. Ce séisme politique intervient alors que la tension était – un temps – retombée entre Alassane Ouattara et Tidjane Thiam. En mars 2024, les deux hommes s’étaient même rencontrés, chacun insistant sur la proximité entre le RHDP et le PDCI. Mais l’entente, qui semblait logique, voire salutaire pour la stabilité du pays, a volé en éclats, constate Marwane Ben Yahmed, directeur de la publication de JA, dans l’article qu’il signe cette semaine sur les dessous de cette affaire d’État.
En cause ? Tidjane Thiam « s’est aliéné le corps intermédiaire, tous partis confondus, y compris le sien, par manque d’humilité », assure un proche d’Alassane Ouattara. L’ancien patron du Credit Suisse, lui, a longtemps attendu, en vain, un signal clair de la part du chef de l’État.
4 – Banque africaine de développement : cinq candidats mais un seul véritable programme ?

Les cinq candidats à la présidence de la Banque africaine de développement : Sidi Ould Tah, Amadou Hott, Bajabulile Swazi Tshabalala, Samuel Munzele Maimbo et Mahamat Abbas Tolli. © Montage JA : Sylvain Cherkaoui pour JA ; DR ; World Bank Group
« High 5 ». Énergie, alimentation, industrialisation, intégration et qualité de vie. Tels sont les « high 5 » issus de la stratégie amorcée en 2015 par la Banque africaine de développement (BAD), les cinq piliers sur lesquels les cinq candidats à la succession d’Akinwumi Adesina fondent la stratégie qu’ils entendent déployer s’ils sont élus à la tête de l’institution, lors du scrutin qui se tiendra fin mai à Abidjan. Amadou Hott, Samuel Munzele Maimbo, Sidi Ould Tah, Mahamat Abbas Tolli et Bajabulile Swazi Tshabalala : tous affirment vouloir rendre la BAD plus agile, plus efficace et plus innovante.
Mêmes objectifs, moyens différents. C’est donc sur les moyens proposés pour atteindre ces objectifs que les candidatures diffèrent, comme le détaille Salimata Koné dans l’article qu’elle consacre aux programmes des différents candidats à la tête de la BAD. On y découvre notamment que trois des cinq candidats misent beaucoup sur le volet « énergie », mais avec des stratégies sensiblement différentes. Sur l’agriculture, certains optent pour renforcer les actions de développement et d’émancipation des femmes, quand d’autres préfèrent miser sur l’industrialisation. Sur les questions sociales, certains mettent l’accent sur le développement rural, d’autres sur les services publics ou la jeunesse… Et vous, de quel candidat vous sentez-vous le plus proche ? Pour le savoir, leurs stratégies respectives sont à découvrir ici.
5 – Au Maroc, bras de fer entre les ONG et le ministre de la Justice

Abdellatif Ouahbi, le ministre marocain de la Justice, porte une réforme contestée du Code de procédure pénale. © MOHAMED DRISSI K. POUR JA
Bataille juridique. Abdellatif Ouahbi, le ministre marocain de la Justice, est engagé dans une bataille juridique avec plusieurs ONG. Au cœur de la polémique, plusieurs dispositions du projet de réforme du Code de procédure pénale. Un texte qu’il défend depuis plus de trois ans. S’il passe en l’état, la capacité pour des organisations de la société civile d’intenter des actions en justice sur des faits de corruption ou de détournement de fonds sera drastiquement réduite.
Retour en arrière. L’argument avancé par le ministre – limiter les « plaintes abusives » – peine à convaincre. Les ONG n’ont pas été les seules à monter au créneau. Khalid El Wali Alami, professeur de droit pénal à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, le résume : « Exiger que toute plainte contre un élu passe d’abord par le filtre de la tutelle administrative est un retour en arrière. C’est à la justice, et à elle seule, de déterminer la recevabilité d’une plainte, non aux ministères concernés. »