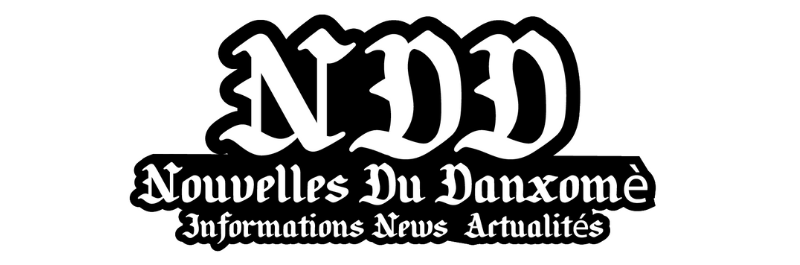Au terme de leur mission scientifique, l’ethnobotaniste Didier Roguet et le conservateur Fred Stauffer dévoilent les besoins de préservation des palmiers au Bénin.
Dr Didier Roguet ne cache pas son état d’âme. La richesse de la flore béninoise et son ancrage dans la société ont marqué l’ethnobotaniste aux Conservatoire et Jardin botaniques de la ville de Genève. « Votre pays est extraordinaire. Il recèle des trésors », confiait-il le 22 juin 2022 au cours d’une causerie scientifique dans le cadre du projet « Multipalms ». Il s’agit d’une initiative de conservation patrimoniale des palmiers forestiers utiles d’Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Bénin. Avec Fred Stauffer, conservateur en chef des herbiers de Genève, il a plongé l’auditoire dans le monde, à la fois complexe et simple, de ces hautes herbes. Première précision : « On n’a pas à affaire à un seul palmier comme le pensent la plupart des gens, mais à des multitudes », martèle Dr Didier Roguet.
Les palmiers font la vie des communautés
Presque tout le monde a le regard tourné vers le palmier à huile quand on évoque ces grandes herbes. Pourtant, cette famille botanique inclut 185 genres et 2 600 espèces. La Malaisie tire le gros lot avec 992 espèces pendant que l’Afrique de l’Ouest n’en compte que 38. Des palmiers utilitaires, Dr Didier Roguet et Dr Fred Stauffer en ont vu de toutes les formes au cours de leur mission scientifique au Bénin. « Au nord, vous avez des espèces de doums qui sont des palmiers sahéliens, facilement reconnaissables. Ils sont utilisés dans les régions où ils poussent pour de l’artisanat en particulier. Les raphias sont, quant à eux, de grands palmiers qui poussent dans les zones humides. Par exemple à Ganvié, vous avez des constructions avec des perches de ces palmiers. Il y a aussi les rotins, des plantes très agressives dont les cannes et les tiges sont utilisées par vos artisans », fait remarquer l’ethnobotaniste.
Au Bénin, comme dans de nombreuses régions du monde, les palmiers sont intimement liés à la vie des populations. Non seulement, ces espèces procurent des matériaux très résistants et parfois plus intéressants que le bois, mais elles sont aussi rattachées aux croyances. Pour ces chercheurs, il y a mille raisons de les conserver. Voilà pourquoi, ils se sont intéressés à la vie des palmiers retrouvés au Bénin et à leur exploitation. « On va à la rencontre des artisans pour essayer de comprendre les filières. On descend dans les marécages où poussent ces palmiers. Ce qu’on recherche sur le terrain, c’est la régénération : le fait de trouver des individus juvéniles autour de ces peuplements », souligne Dr Didier Roguet.
Le palmier doux, une première au Bénin
Dans leur aventure scientifique, Didier Roguet et Fred Stauffer ont croisé de nombreuses espèces qu’il faut protéger à tout prix comme le palmier doux. C’est d’ailleurs la toute première fois qu’on la signalait dans la flore du Bénin. Selon le document de référence appelé flore analytique du Bénin, Hyphaene guineensis n’existe pas chez nous. La découverte a été alors une joie pour l’équipe. Malheureusement, son milieu est très dégradé notamment à cause de la conversion de son habitat en sites maraichers et de l’urbanisation. « Il a le désavantage de ne pas être utilisé dans cette région du Bénin. Les gens s’en préoccupent peu, si ce n’est son aspect décoratif. On n’utilise ni le fruit, ni la fibre si ce n’est que pour tresser des paniers et des chapeaux. Il faut les protéger absolument dans des plans de conservation locale », fait remarquer Dr Didier Roguet. Des usages extraordinaires, l’équipe en a découvert aussi comme la vente de crabes dans des emballages de feuilles de palmiers au poste de péage de Grand-Popo. « C’est quelque chose qui est totalement unique au Bénin. On ne la trouve nulle part ailleurs en Afrique de l’Ouest. C’est très interpellant pour nos études », ajoute-t-il.
Éloigner les menaces
Ce journal de bord scientifique ne donne pas qu’une idée de la place des palmiers dans la vie des communautés. Il reflète aussi les pratiques à risque qui peuvent les faire disparaître. « Quand on abat pour extraire la sève, ce n’est évidemment pas durable. Le palmier ne pourra pas être de nouveau sur ses pieds », déplore Dr Didier Roguet. Il faut alors prendre des mesures urgentes de sauvegarde. Certaines sont déjà en cours de mise en œuvre. « On essaie de la faire pousser sous une ombrière que Dr Kifouli Adéoti, maître de conférences des universités, et Dr Hospice Dassou ont fait construire au jardin botanique de l’Uac. Les solutions qu’on peut apporter, c’est la domestication partielle ou accélérée. Il faut que les bonnes pratiques durables soient diffusées. S’il n’y a plus de matières premières, il n’y aura plus d’artisanat. Il peut y avoir aussi des échanges entre les communautés sur des pratiques durables d’exploitation », a-t-il ajouté. Les artisans devraient pouvoir compter sur les paysans locaux pour continuer à avoir dans le futur de la matière première. Ainsi, protéger les palmiers, ce sera protéger la vie, des sources de survie et la foi?