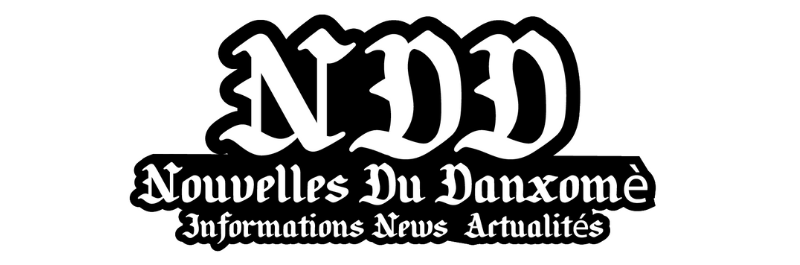En marge du trentenaire du sommet de Rio 1992, un état des lieux de la biodiversité a été fait à travers les indicateurs contenus dans l’étude «d’évaluation et hiérarchisation des menaces portant sur la biodiversité au Bénin ». Les acteurs, eux, gardent espoir.
La biodiversité béninoise reste à découvrir et à explorer. La situation présentée dans le rapport de mission d’évaluation de l’état de la biodiversité du Bénin montre qu’il y a du chemin à faire. Le 13 juillet 2022, en marge du trentenaire du sommet de Rio 1992, Is Deen Akambi, assistant technique de Biodev 2030, a levé un coin de voile sur le contenu du rapport. L’évaluation des écosystèmes et habitats des divers groupes taxonomiques montre une tendance à la régression des superficies entre 2005 et 2015. Quant à la diversité taxonomique, il y est souligné que le Bénin compte environ 2 807 espèces de plantes, 552 espèces de champignons supérieurs, 603 espèces d’oiseaux, 157 espèces de mammifères (dont 2/3 de petits mammifères), 103 espèces de reptiles, 221 espèces de poissons d’eau douce, 136 espèces de poissons marins et saumâtres et 51 espèces d’amphibiens. Cette évaluation a été faite par une équipe conduite par le Prof Brice Sinsin, directeur du Laboratoire d’Ecologie Appliquée. Les experts se sont basés sur la bibliographie existante, des données d’enquêtes et de terrain. Les métriques «Star» basées sur la liste rouge des espèces de l’Uicn ont été également utilisées. Des analyses critiques ont ensuite été faites au regard des expériences de terrain et des avis des experts sur l’effectivité des valeurs générées. Entre autres leçons à tirer, la flore du Bénin comporte très peu d’espèces endémiques. Seulement quatre espèces peuvent être considérées comme endémiques. La tendance de la population d’environ 73 %, soit 2 061 des espèces végétales est inconnue. La quasi-totalité (99,5 %) des champignons inventoriés ont un statut de conservation. Parmi les 2 807 espèces de la flore béninoise, seulement 106 espèces sont classées dans la catégorie des espèces menacées sur la liste rouge du Bénin, contre 57 espèces sur la liste rouge de l’Uicn. Du côté des insectes, le document souligne que la majorité (28) des espèces inscrites sur la liste rouge du Bénin ne sont pas encore évaluées et la tendance de leur population reste inconnue jusqu’à présent. Ce sont des limites à combler pour assurer la conservation durable et la pérennité de cette classe.
Les racines du mal
Pendant ce temps, sur le terrain, les menaces forcent le déclin. «À l’unanimité, les données de la littérature et les avis des experts indiquent une baisse de la population des espèces au cours du temps malgré la présence et l’accroissement du nombre de massifs forestiers et de réserves de biodiversité représentant actuellement environ 25 % du territoire national », résume le rapport. Plusieurs défis ont été identifiés et hiérarchisés. Pour Is Deen Akambi, la part des efforts à faire pour réduire les menaces est de 79 % dans le score total calculé. « Cela signifie que la plus grande contribution à la conservation des espèces pourrait être faite par la réduction des menaces et non la restauration des habitats qui représente seulement 21 % du score global », martèle-t-il. Au nombre des menaces qui viennent en tête, il y a l’utilisation des ressources biologiques, l’agriculture, le développement résidentiel et commercial. L’exploitation forestière et la récolte du bois, l’urbanisation, la chasse et la collecte d’animaux terrestres sont aussi à prendre en compte. « On voit qu’il n’y a pas que l’agriculture. Mais ce secteur en cause du fait des besoins de surface, des pratiques agricoles peu recommandées qui ravagent la végétation. Quand nous étions jeunes, il fallait soulever quelques briques pour avoir des verres de terre. Nous avons également vu que l’exploitation forestière est un secteur sur lequel il faut travailler», explique Is Deen Akambi.
Conserver et dialoguer
Deviennent indispensables, des stratégies durables de conservation de la biodiversité, visant une conservation ex-situ (pour les espèces menacées ou en déclin) en plus de la conservation in-situ (pour les espèces non encore menacées). Dans le même temps, le dialogue avec les différents acteurs est primordial. « Nous travaillons dans une approche de dialogue. Nous avions fait des consultations nationales pour diffuser les résultats de ces études. Nous projetons de faire la validation d’un second rapport qui nous fixe sur comment il faut faire ces discussions avec les acteurs, comment il faut les mobiliser. Il faut créer le déclic », rassure l’assistant technique de Biodev2030. Convaincre les acteurs économiques ne sera pas non plus facile. Pourtant, il le faut. «Les gens ne se mobilisent que s’ils y trouvent leur intérêt. Il faut leur apporter des solutions. Aujourd’hui, il y a un marché important qui se développe autour du bio, que ce soit le coton, le soja, le riz, etc. Il y a des labels qui sont érigés. Pour que le producteur à la base puisse en bénéficier, il faut qu’on prenne en compte les contraintes », ajoute-t-il. Le rapport recommande aussi le renforcement de la recherche scientifique dans la connaissance de l’écologie des espèces afin de combler les lacunes. Une actualisation de la liste rouge des espèces menacées du Bénin devient nécessaire, à l’horizon 2025.
Inverser la tendance
Se référant, le 12 juillet 2022, au 6e rapport national sur la diversité biologique au Bénin, Luc Gnacadja pense qu’il reste du chemin à faire. À en croire l’ancien ministre de l’Environnement, si le discours est bon et a changé, la manière d’investir n’a pas encore suivi. Les pratiques aussi doivent changer. « Parce qu’on ne tient pas compte de notre biodiversité, en particulier, celle des sols, nous dégradons deux fois plus vite que nous ne protégeons nos terres. En 2000 et 2010, nous avons dégradé 1,9 % du territoire national. C’est le Bénin utile qui se rétrécit. Mais ce n’est pas une fatalité. On peut l’inverser. Et il faut le faire vite», déclare l’ancien Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La prise de conscience demeure donc capitale. Les efforts de sensibilisation ont besoin d’être renforcés. « Pour inverser la tendance, il faut asseoir les bases juridiques necessaire pour mieux réguler. Je pense que des progrès ont été accomplis dans ce sens. L’Homme étant l’acteur principal de la perte de la biodiversité, chacun doit prendre conscience. Tout le monde doit être concerné», insiste Dr. Augustin Orou Matilo, Point focal de la convention sur la diversité biologique.