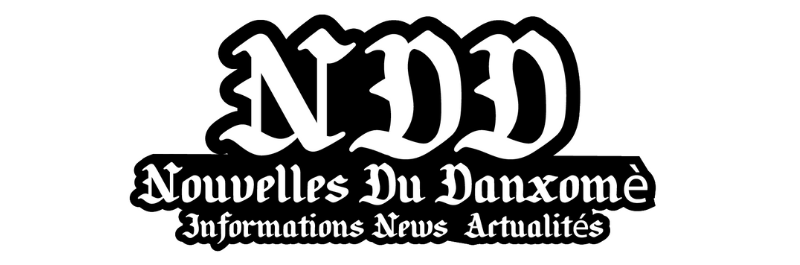C’est un constat que partage la grande majorité des participants de la deuxième conférence sur le Changement climatique, la recherche et la résilience (2CR2), qui vient de se clore à Djibouti : le manque d’intérêt des responsables politiques africains pour les sujets climatiques est plus qu’une erreur, elle est le signe d’un inquiétant déséquilibre. Celui qui persiste entre les bailleurs de fonds, majoritairement occidentaux et souvent déconnectés des réalités africaines, et les chercheurs dont ils financent les travaux.
« Il faut se détacher des philosophies occidentales, qui ne ressemblent pas à l’Afrique. On doit penser localement et se développer localement », estime le Pr. Cheikh Mbow, directeur du Centre de suivi écologique du Sénégal. Pour ce scientifique, qui est également membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la 2CR2 ferait donc presque figure d’exception. « C’est rare qu’une conférence scientifique mobilise aussi des politiques du continent, comme c’est le cas ici », se félicite-t-il.
Faire face à la baisse des financements
De fait, l’Observatoire régional de la recherche et du climat (Orrec), qui organise l’évènement, est le fruit d’une volonté politique clairement affichée : celle du président djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh. En deux ans d’existence, l’Orrec a lancé plusieurs projets, très concrets, travaillant notamment à la conception de modèles prédictifs des précipitations afin d’anticiper les sécheresses et d’accompagner ainsi les éleveurs nomades de la région. L’un des objectifs est également d’alimenter une base de données en sources ouvertes couvrant la Corne de l’Afrique, élaborée en collaboration avec l’université française de Dijon, qui doit voir le jour en mai prochain.
Mais, même lorsque le soutien politique est là, il suffit rarement. L’Orrec s’est donc lancé dans une quête de nouveaux partenaires financiers, pour pouvoir répondre aux enjeux à l’échelle régionale. « Le gouvernement djiboutien va devoir réduire les financements. Nous avons obtenu des engagements de la part de chefs d’État de la région, mais en dehors des bailleurs internationaux, aujourd’hui, seul Djibouti porte ce projet », constate Moussa Mehdi Ahmed, directeur de l’Orrec. Nabil Mohamed Ahmed, ministre djiboutien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dit en écho ses « craintes de voir certains de nos partenaires les plus fiables baisser le niveau des financements ».
Le cas de Djibouti est loin d’être isolé : à l’échelle internationale, la tendance est au désengagement progressif des financements en provenance des pays industrialisés, pourtant principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Depuis l’investiture de Donald Trump, les États-Unis ont ainsi annulé le versement de 4 milliards de dollars destinés à abonder le Fonds vert des Nations unies.
Washington a également entamé le démantèlement de l’USaid, l’agence de développement qui irriguait jusque-là de nombreuses initiatives parfois vitales pour le continent. À Djibouti, les regards se tournent donc vers la France et l’Union européenne, partenaires historiques du pays. Mais pour l’heure, « nous avons pu sécuriser les financements pour les projets actuels, mais avons été forcés de mettre en standby les projets futurs », confie Nabil Mohamed Ahmed.
Se faire entendre des politiques
Face à cet assèchement des financements occidentaux, le continent doit compter sur ses propres forces enjoint le Malien Youba Sokona, vice-président du Giec. « Il faut plus de coopération entre les pays du Sud, en particulier en Afrique. Et il faut renforcer les moyens à dispositions des étudiants africains qui, aujourd’hui, ont un accès trop limité à la littérature scientifique, car les abonnements coûtent très cher », juge Youba Sokona.

Pendant les trois jours de cette conférence, à laquelle ont participé plus de 400 chercheurs et représentants d’institutions internationales et d’ONG, la majeure partie des rapports et publications scientifiques présentés portaient pour leur grande majorité le sceau des bailleurs de fonds internationaux, de la FAO à la Banque mondiale. Un constat qui pose question à Youba Sokona. « On a le sentiment que, ce qui compte le plus pour eux, c’est la visibilité. Mais ce qui importe réellement, ce sont les résultats, pas les logos », lâche-t-il.
la suite après cette publicité
Lors des échanges, plusieurs pistes ont été évoquées. À la question « comment faire pour faire connaître nos travaux aux responsables politiques ? », lancée par le chercheur camerounais Yves Tchiechoua, spécialiste de la pollution des sols aux microplastiques, Youba Sokona a apporté une réponse. Pour lui, il faut prendre exemple sur les rapports du GIEC, qui sont rédigés à l’issue d’un dialogue soutenu entre scientifiques et décideurs politiques. « C’est la raison pour laquelle les rapports du Giec sont aussi reconnus sur le plan international », juge le chercheur.