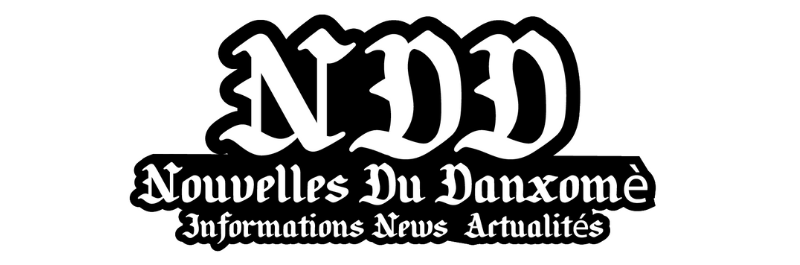romulguée le 16 février 2022, la loi sur l’hygiène publique attend des décrets d’application pour faire effet complet sur le terrain. Membre du Cadre de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l’eau et de l’assainissement au Bénin (Canéa), Félix Adégnika dévoile des aspects sur lesquels, des textes complémentaires sont importants.
La Nation : Qu’est-ce qui a bougé depuis la promulgation de la loi sur l’hygiène publique ?
Félix Adégnika : La loi 2022-04 sur l’hygiène publique votée le 20 janvier 2022 a été promulguée le 16 février 2022 par le président de la République, soit exactement 9 mois maintenant. Depuis, les choses n’ont bougé que lentement. Le coup de pouce est venu de la présidence de la République avec le Comité ad hoc chargé de prendre les textes d’application des lois votées depuis 2016. Ce Comité met la pression sur les ministères auteurs des lois promulguées en 2022 afin que les textes d’application soient pris avant la fin de l’année. On note donc une certaine effervescence au niveau des services concernés du ministère de la Santé et du ministère du Cadre de vie. Un répertoire des textes référés sur la loi est déjà disponible ainsi que des projets de textes réglementaires et normatifs.
Bien que plusieurs textes soient du ressort du ministère de la Santé, il en existe plus spécifiques au secteur de l’eau, de l’alimentation, du commerce et de la gouvernance locale. Les ministères en charge de ces secteurs semblent ne pas être concernés par la prise de textes d’application de la loi 2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique. Il n’y a pas que les textes d’application. On oublie vite que le 1er principe en droit est que nul n’est censé ignorer la loi. Pour qu’il en soit ainsi, il faut aussi que la loi soit vulgarisée dans un langage facile d’assimilation par les différentes couches sociales. Informer et sensibiliser, ce sont encore des chantiers qui attendent d’être démarrés et où le Cadre de concertation des acteurs non étatiques des secteurs de l’eau et de l’assainissement au Bénin (Canéa) attend de jouer encore sa partition.
Je ne vous apprends rien si je vous dis que la loi prescrit un minimum d’infrastructures publiques à mettre en place par l’autorité locale, telles que les toilettes publiques, sans quoi, son application serait difficile. Il y a quelques jours, la police a interpellé une vingtaine de citoyens indélicats sur le sujet. Il urge que des dispositions soient prises pour une synergie d’actions, une mobilisation sociale autour de la question des conditions effectives d’application de cette loi. Et ce, à travers la prise des textes d’application, la disponibilité d’un minimum de services publics essentiels, la vulgarisation de la loi et la sensibilisation des populations.
Une nouvelle rentrée scolaire a commencé avec toujours un déficit de toilettes dans les écoles. Or la loi en fait une obligation. Comment peut-on situer les responsabilités ?
L’un des champs d’application de cette loi est I‘hygiène des établissements des différents ordres d’enseignement et des établissements sanitaires, donc du domaine public. Les exigences pour les écoles sont, entre autres, la disponibilité de : source d’approvisionnement en eau potable et installations sanitaires sexo spécifiques, la qualité de l’alimentation. Je ne suis pas certain que ces trois services soient disponibles dans la majorité de nos écoles. Des reportages diffusés la semaine dernière ont montré des situations déplorables qui interpellent tous les usagers de l’école béninoise. Qui est coupable ? Tout le monde, donc personne. Il faut que la nouvelle loi soit popularisée afin que personne ne dise : « Je ne savais pas ».
Quels sont les aspects de la loi qui ont besoin de décrets d’application ?
Pour cette loi de 186 articles, il a été relevé 22 textes d’application dont une bonne moitié compatible avec des textes qui existent déjà mérite simplement d’être revisitée et révisée. D’autres sont des dispositions normatives ou réglementaires à prendre au niveau de l’administration déconcentrée ou locale. Tout est essentiel, mais on peut mettre l’accent sur les décrets relatifs aux eaux de boisson ensachées ou embouteillées (pure water), sur les examens médicaux des personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires, conditions d’utilisation des puits et forages pour la consommation, sur le traitement des déchets, etc.
Quelles sont les actions que mène la société civile pour faire bouger les lignes ?
Le Canéa a été à l’avant-garde du vote de cette loi en souffrance au Parlement béninois depuis près d’une dizaine d’années. Il s’est réjoui de sa promulgation et se tient disponible à contribuer à réunir les conditions optimales de sa mise en œuvre. Le Canéa, avec l’appui de son partenaire Nyel, a élaboré une note de plaidoyer qui montre la pertinence et l’urgence de la prise des textes d’application, mais aussi la vulgarisation de cette loi. Tout en offrant son expertise et sa disponibilité, le Canéa a élaboré une stratégie couplée à une feuille de route pour l’atteinte de ces deux objectifs. Le Réseau des acteurs des médias pour l’Eau, l’Environnement et le Climat (Ramec) est tout aussi au premier plan. Pour le Canéa, il faut un leadership opérationnel pour conduire un processus inclusif avec des parties prenantes volontaires et engagées?