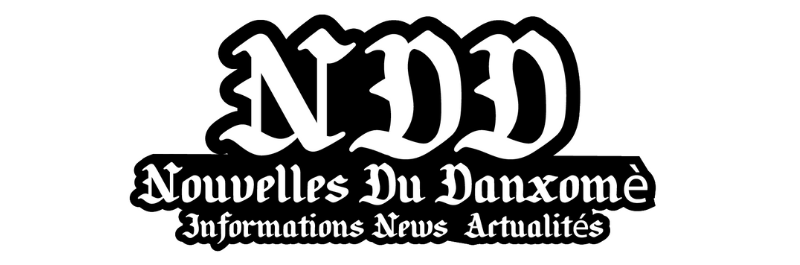Trois actions phares pour placer l’agroécologie au cœur de l’adaptation climatique. C’est ce que proposent des acteurs de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (Afsa) à la suite des assises tenues à Addis-Abeba du 19 au 21 septembre 2022.
L’Afrique peut conduire le monde dans la transition vers des systèmes alimentaires durables grâce à l’agroécologie. C’est le leitmotiv des petits exploitants agricoles, des jeunes, des femmes, des chercheurs et scientifiques, des écologistes, faisant partie de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (Afsa). Il s’agit du plus grand mouvement de la société civile du continent représentant 200 millions de paysans, pêcheurs, éleveurs, consommateurs, groupes confessionnels et peuples autochtones. Réunis à Addis-Abeba en Ethiopie du 19 au 21 septembre dernier pour établir une feuille de route de l’Afrique pour l’adaptation par l’agroécologie, ils lancent un appel à l’action à la Cop 27 et au-delà. « Nous demandons que la Cop 27 place l’agroécologie au centre de l’adaptation climatique de l’Afrique, en créant une résilience pour les paysans, les pêcheurs, les pasteurs, les communautés autochtones et leurs systèmes alimentaires », ont-ils déclaré dans un communiqué de presse à la fin de leurs assises. Ils appellent ainsi la Cop 27 à trois actions phares. Les membres de l’Afsa invitent à « reconnaître l’agroécologie pour l’adaptation ». Il s’agit de donner la priorité à l’agroécologie pour transformer le système agroalimentaire, de renforcer la résilience et permettre aux paysans, aux pasteurs et aux pêcheurs de s’adapter au changement climatique, d’inclure l’agroécologie dans les négociations climatiques de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ensuite, l’organisation panafricaine suggère de mettre les petits exploitants et les communautés autochtones, y compris les femmes et les jeunes, au centre de l’adaptation en les engageant de manière significative dans les négociations de la Cop 27. La troisième action phare que proposent les membres de l’Afsa, c’est d’axer le financement climatique sur les systèmes alimentaires durables à travers l’orientation de ce financement vers l’agroécologie. « Le moment est venu d’augmenter de manière appropriée et délibérée le financement des paysans, des pêcheurs, des éleveurs et des communautés autochtones afin de mettre en place des systèmes alimentaires durables basés sur l’agroécologie”, annonce l’institution panafricaine.
Un constat affligeant
Le communiqué informe, que l’Afrique subit au quotidien les effets de l’urgence climatique. La hausse des températures, les inondations, les tempêtes, les sécheresses et la dégradation des terres touchent en premier lieu les petits exploitants africains. Obligés de s’adapter pour préserver leurs moyens de subsistance et nourrir leurs familles, ils ne bénéficient que d’un soutien ou d’un accès négligeable au financement climatique. L’Afrique a un énorme potentiel, une riche diversité culturelle, des ressources naturelles et des jeunes à l’esprit créatif. Pourtant, l’agriculture africaine souffre d’un sous-investissement et de lacunes politiques qui empêchent l’accès au capital productif et aux terres. « Nous avons besoin d’une transition juste et radicale, loin de l’agriculture industrielle, des monopoles d’entreprise et des fausses solutions climatiques, vers la souveraineté alimentaire et l’agroécologie ».
En associant des générations de savoirs indigènes, d’innovations scientifiques et paysannes et les processus naturels d’un écosystème, les systèmes alimentaires agro écologiques sont capables de s’adapter à la crise climatique et même contribuer à la résoudre. Les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochtones et les communautés locales ont recours à l’agroécologie pour gérer leurs terres de manière durable, produire des aliments nourrissants qui célèbrent leur patrimoine culturel et renforcer les marchés et les économies locales. Plus important encore, en intégrant la diversité et la résilience, l’agroécologie permet d’absorber le carbone et de s’adapter à la menace existentielle du changement climatique, comme le reconnaît le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat?