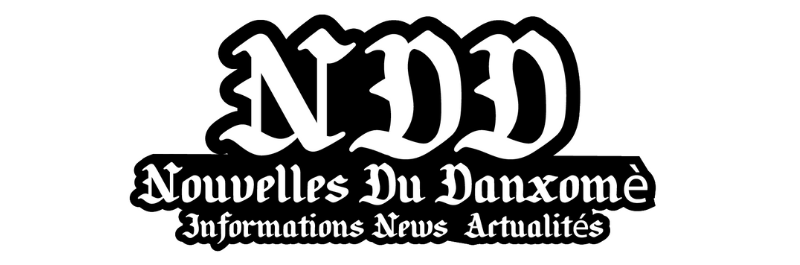Lorsque survient une fracture à la suite d’un accident de la route, d’un choc ou d’un traumatisme, le recours à un traitement s’avère indispensable. Mais pendant que certains choisissent la voie de l’hôpital, d’autres préfèrent s’en remettre aux praticiens traditionnels pour se faire soigner. Les résultats satisfaisants que saluent les patients prédisposent cette pratique à un bel avenir.
Au domicile d’Antoine Adjadossodji Oké, mardi 31 mai dernier, dans le village de Glo-Djigbé, à environ 30 kilomètres de Cotonou, il est à peine 9 heures du matin. Sous la paillote érigée au fond de la grande cour de la concession, on aperçoit aisément quelques patients, reconnaissables à leurs bandages. Pendant que ces derniers patientent, le praticien est occupé à dispenser des soins à l’un des malades «hospitalisés». Connu sous le surnom «Yellow », ce quinquagénaire est reconnu dans la zone comme un expert en santé des os. Enfants, jeunes et personnes âgées défilent tous les jours dans sa concession pour bénéficier de ses soins. Pendant près de trois heures d’horloge passées sur les lieux, le quinquagénaire était à la manœuvre avec comme seuls moyens de travail, de l’huile de palme communément appelée huile rouge et ses mains. A tour de rôle, chaque patient passe devant le praticien pour bénéficier de la séance de massage approprié à sa situation. Des séances assez éprouvantes pour certains, tant la douleur est encore présente. Pas de nouveau patient reçu cette matinée, rien que des patients en cours de traitement depuis des jours ou semaines.
Un savoir-faire reconnu
Le traitement traditionnel des fractures est une pratique qui date de nos ancêtres et se transmet de génération en génération. Comme Antoine Adjadossodji Oké, ils sont des centaines à pratiquer cette activité au Bénin et se retrouvent sur toute l’étendue du territoire national. Ils n’ont pas besoin de publicité particulière; leur savoir-faire est reconnu dans la communauté et le bouche à oreille suffit pour faire converger vers eux, les patients dans le besoin.
« Je suis né dans le travail de traitement des os. J’ai vu faire mon frère et mon père. Ce travail est un don de Dieu, ce n’est pas un métier qu’on apprend », explique Antoine Adjadossodji Oké. Comme son géniteur, il en a fait son activité principale et passe presque tout son temps à s’occuper des malades. Il assure soigner toutes sortes de fractures à l’exception de celles qui concernent la tête. Il se veut assez rationnel dans sa démarche : « Avant de traiter un malade accidenté, j’exige que la personne aille se faire administrer les premiers soins à l’hôpital et fasse la radiographie qui permet d’apprécier l’ampleur de la fracture ». Il reçoit toutes catégories de patients; les nourrissons, jeunes et vieux.
Huit personnes séjournaient chez lui au moment de notre passage. En dehors de ces malades « hospitalisés », il reçoit au moins une quarantaine de patients par semaine. Il s’agit des patients nouvellement admis, en cours de traitement ou en rééducation. Malgré sa capacité à prendre en charge toutes sortes de fractures, Antoine Adjadossodji Oké reconnait qu’il y a quelques rares cas qu’il rejette au vu de leur complexité. Il leur conseille alors d’aller à l’hôpital pour se faire soigner ou se faire amputer le membre.
Le praticien dit ne pas s’épanouir pour autant dans ce travail puisque les patients, pour la plupart, sont démunis et ne font que se plaindre qu’ils n’ont pas d’argent. «On est obligé de négocier avec eux puisqu’on ne peut pas les renvoyer dans la difficulté. Généralement, je prends ce qu’ils donnent », se plaint-il. Il plaide pour que les autorités sanitaires qui ont connaissance de son travail, puissent faciliter la tâche à ses patients. « Lorsque je demande aux patients d’aller faire la radiographie, le bon que je leur fais est rejeté dans les hôpitaux, les obligeant à recourir d’abord à un professionnel de la santé avant de faire cet examen sans lequel je ne peux pas bien faire le diagnostic et traiter correctement le patient », poursuit-il.
Une relève assurée
Comme dans la plupart des familles qui s’adonnent à cette activité, la transmission du savoir se fait de génération en génération.
Chez Antoine Adjadossodji Oké, la relève est assurée : «Mes enfants ont commencé à assurer la relève et m’aident à prendre soin des patients », explique-t-il.
Même constat chez le vieux Marcellin Agossou connu sous le nom de « Agbakpa» à Malanhoui dans la commune d’Adjarra, à quelques encablures de Porto-Novo. Ici, c’est la fille ainée du praticien, Juliette Agossou qui explique comment les patients sont pris en charge depuis des décennies dans ce lieu dont la réputation est connue dans le département. « Cette pratique n’est pas de notre temps, ce sont nos aïeuls qui l’ont léguée à nos parents qui à leur tour, nous l’ont léguée au point où tous les enfants de cette famille s’y adonnent quelle que soit leur formation ou activité». Elle assure que quelle que soit la nature de la fracture, les patients trouvent satisfaction. Ici aussi, explique-t-elle, «nous exigeons la radiographie avant tout traitement et lorsque nous jugeons certains cas très compliqués, nous les renvoyions vers l’hôpital pour se faire traiter ».
Des ‘‘hospitalisations’’ sur place se font également lorsque le patient vient de très loin ou lorsque la situation de la fracture exige son immobilisation. Au-delà des retombées financières, insignifiantes selon elle, que procure cette activité, c’est surtout le sentiment d’être utile à la communauté et de pouvoir soulager les peines des personnes en souffrance qui constitue, selon elle, la grande satisfaction que tire le praticien de l’activité.
• Des patients satisfaits
La plupart des patients qui fréquentent ces praticiens traditionnels sont des victimes d’accidents de la route assortis de fractures à divers niveaux. Le réflexe de toute personne accidentée est de se rendre ou d’être portée dans un centre de santé pour les premiers soins. Il se trouve que certaines victimes, ayant reçu les premiers soins à l’hôpital ou non, choisissent le traitement de la fracture en milieu traditionnel. Les patients rencontrés sur les lieux disent avoir fait ce choix, pour des raisons financières et/ou par manque de confiance au traitement médical qui, rapportent-ils, dure et ne réussit pas toujours. Leurs témoignages renseignent davantage sur leurs motivations réelles et leur degré de satisfaction.
Emile Kpossaton, enseignant: « Victime d’un accident de la circulation le 13 avril dernier dans la zone de Sékou, j’ai eu des fractures au niveau de la clavicule et du poignet gauche. J’ai été à l’hôpital, ils m’ont demandé un million de francs Cfa pour faire une intervention chirurgicale. Il y a très longtemps que j’entends parler du vieux qui s’occupe de la santé des os ici à Glo-Djigbé. J’ai décidé d’aller chez lui pour voir dans quelle mesure il peut me soulager parce que parfois, on fait l’opération, on met le fer mais ça ne réussit pas. A comparer aussi les coûts des prestations à l’hôpital et ici, j’ai préféré venir ici. Je peux vous dire que depuis un peu plus d’un mois qu’on a commencé le traitement, ça va. Je ne pouvais pas bouger la clavicule ni le poignet, maintenant, je suis satisfait ».
Elysée Hounto, vitrier : «J’ai eu un accident de la route avec fracture à la cheville droite. J’ai été à l’hôpital pour les premiers soins et le pied a été plâtré. J’ai gardé le plâtre pendant deux mois, mais après qu’on l’a enlevé, je n’arrivais toujours pas à bien marcher. C’est la raison pour laquelle je suis venu chez le praticien traditionnel. Cela fait cinq jours que j’ai commencé et je sens déjà une amélioration, je peux au moins mettre le pied à terre et marcher ».
Gratien Bonou, commerçant: « Je suis ici pour soigner une fracture au niveau de la jambe gauche que j’ai eue à la suite d’un accident de la route. Après les premiers soins dans une clinique, mon oncle m’a amené ici parce que l’un de nos cousins y avait séjourné. Cela fait environ un mois et demi que je suis gardé ici. Par rapport à ma situation du début, je sens une amélioration mais je ne marche pas encore sur le pied. Le vieux me rassure que d’ici un mois, je pourrais le faire ».
Micheline Abandogan, jeune mère de famille : « Je suis ici depuis deux mois et demi à la suite d’un accident de la route qui a entrainé une fracture à la jambe droite. J’ai d’abord été à l’hôpital pour les premiers soins et quand ils ont constaté que j’ai une fracture, ils m’ont conseillé de venir ici.
Ça va de mieux en mieux et j’espère sortir d’ici dans quelques semaines ».
Yémalin Gabin Gotohoun, déclarant en douanes : «A la suite d’un accident de la route, j’ai une fracture au niveau de la clavicule et du poignet gauche. Je suis dans la troisième semaine de traitement avec le vieux et pour vous parler sincèrement, c’est un vieux qui est très efficace. A voir ce qu’il fait, je lui ai conseillé de tout faire pour que cette pratique ne disparaisse point. Si on peut jumeler ça avec la médecine conventionnelle, ce serait très bien. C’est le hasard qui m’a amené vers lui. J’ai eu l’accident au niveau de Zè et je m’efforçais de conduire la moto et de rentrer chez moi quand la vendeuse de carburant chez qui j’ai marqué un arrêt m’a suggéré d’aller chez le vieux. Je vous assure que l’accueil a été très chaleureux. Je ne pouvais pas croire qu’en deux semaines, j’allais bouger ce bras ».
Parfait Akouèou : « Quand j’ai eu l’accident, je paniquais, je voulais aller à l’hôpital quand les gens m’ont conseillé d’aller chez les praticiens traditionnels car chez eux, disaient-ils, la guérison est plus rapide. On m’a amené chez un praticien traditionnel mais après plus d’un mois de traitement, je n’étais pas satisfait. Un ami qui a déjà pratiqué le vieux m’a demandé d’aller faire la radio afin qu’il m’amène chez lui. Ce que j’ai fait. Je puis vous dire que depuis deux semaines que j’ai commencé, je peux plier mon bras, je peux me gratter le corps. Ce qui n’était pas le cas avant puisque le bras était toujours tendu. Nous allons prier pour que Dieu donne longue vie à ceux qui nous aident. Je voudrais demander aux autorités d’avoir un œil sur ce qui se fait dans ce milieu et de faire des enquêtes sur les praticiens sinon, il y en a qui causent des dommages aux patients. Ils ne sont pas du domaine et à cause de l’argent, ils s’improvisent guérisseurs ».
La collaboration entre les deux médecines souhaitée
La médecine traditionnelle, de par son accessibilité, sa proximité géographique et culturelle, son caractère holistique, demeure pour de nombreux Béninois, le premier recours pour faire face aux ennuis de santé. Pour parvenir à une collaboration tant souhaitée entre la médecine traditionnelle et celle dite conventionnelle, beaucoup d’obstacles restent à surmonter.
Selon certains spécialistes, la médecine traditionnelle béninoise fait partie des plus riches du continent, parce que le peuple béninois a su protéger ses pratiques ancestrales de guérison, transmises par ses sages de génération en génération. Dans une interview au journal « La Nation » en novembre 2016, le professeur Rock Houngnihin alors coordonnateur du programme en charge de la médecine traditionnelle déclarait que «plus de 10 500 tradipraticiens délivrent une grande partie des services de santé à 80 % de la population ».
Le traitement des fractures par les tradipraticiens n’est qu’une branche de la médecine traditionnelle. Si la pratique perdure jusqu’à ce jour, c’est bien parce que des patients y trouvent satisfaction et qu’il y a forcément de bonnes choses qui se font par les praticiens. Malgré le développement de la science et de la technologie, l’engouement pour ce type de traitement au Bénin reste intact. Le souhait des populations est de voir instaurée une certaine passerelle entre les deux médecines. L’intégration de la médecine traditionnelle au système de santé reste une préoccupation pour l’Organisation mondiale de la Santé (Oms) qui accompagne les Etats dans ce sens. Ella a consacré la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle (Jamt) célébrée en 2017 à cette thématique : « Intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé : le chemin parcouru jusqu’à présent ». Occasion pour les divers acteurs de faire le point des progrès réalisés et des écueils qui entravent la concrétisation de cette ambition.
Le Bénin dispose d’un cadre réglementaire et d’un code d’éthique et de conduite pour la pratique de la médecine traditionnelle. Toutes choses qui ont favorisé la production en quantité commerciale, des médicaments traditionnels standardisés.
Cependant, des efforts restent à fournir pour garantir la qualité, l’efficacité et l’innocuité des médicaments traditionnels à base de plantes. De même, faut-il relever les défis de la protection des propriétés intellectuelles et des connaissances ; de l’assainissement du secteur ; de la documentation des pratiques, que ce soit les pratiques en matière de médecine traditionnelle générale, de santé mentale, d’accouchement traditionnel, de traitement des fractures, de soins curatifs et préventifs. Il s’agit d’accompagner les détenteurs des savoirs traditionnels et de préserver ainsi ce potentiel médical inestimable qui fait partie de notre patrimoine culturel. Il est question aussi d’assainir le milieu en extirpant du rang des tradipraticiens, les charlatans sans aucun savoir, qui créent des nuisances aux populations. C’est le rôle de l’Etat, à travers le programme en charge de la médecine traditionnelle.