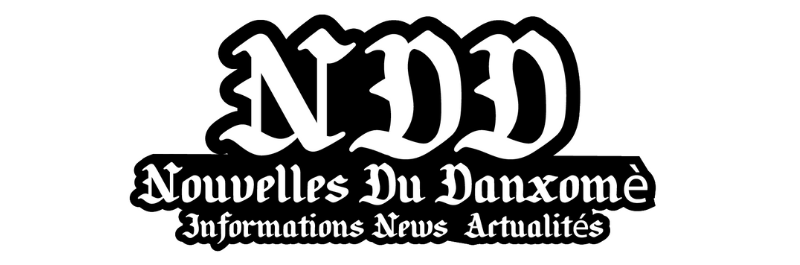Bonjour à toutes et à tous,
Bienvenue dans cette nouvelle édition du Brief de Jeune Afrique, qui vous propose de revenir sur les cinq articles qu’il ne fallait pas manquer au cours des sept derniers jours.
Au programme de cette édition :
- Les déboires de Tidjane Thiam et leurs conséquences
- Les dissensions au sein de la junte malienne
- Que vaut le souverainisme économique prôné par certains pays en Afrique ?
- Climat : des solutions africaines pour gagner la bataille de l’adaptation
- Les « brouteurs » : retour sur l’arnaque en ligne devenue phénomène en Afrique de l’Ouest
_____________________________
1. Tidjane Thiam inéligible : les conséquences d’un séisme politique
Radiation. Coup de tonnerre, le 22 avril : à six mois de la présidentielle, Tidjane Thiam, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a été radié des listes électorales par une décision de justice. Il est donc, de fait, inéligible. Et le délibéré n’est susceptible d’aucun recours.
La cause ? Selon la juge Aminata Touré, qui s’appuie sur un article du Code de la nationalité, Tidjane Thiam n’était plus citoyen ivoirien depuis 1987, lorsqu’il est devenu français. S’il a bien renoncé à la nationalité française en mars dernier, il s’est inscrit sur les listes électorales en décembre 2024…
Colère. L’argument juridique ne convainc pas au sein du PDCI. Le patron du plus vieux parti de Côte d’Ivoire, qui se voit ainsi écarté de la course à la présidentielle, juge que cette radiation est « injuste, injustifiée et incompréhensible ».
Interrogations. S’il dénonce un « déni de justice indigne d’une démocratie » et que ses partisans assurent que ce sera « Thiam ou rien », nombre de questions se posent au lendemain de cette décision.
Également membre du PDCI, Jean-Louis Billon, qui avait finalement décidé de ne pas présenter sa candidature face à celle de Tidjane Thiam lors de la convention d’investiture, peut-il être une alternative crédible ?
la suite après cette publicité
Une alliance des « inéligibles » est-elle envisageable ? Pour l’heure, cette éventualité est plus qu’improbable. L’ancien président Laurent Gbagbo, qui n’a pas obtenu sa réinscription sur les listes électorales, est resté silencieux depuis l’annonce de la radiation du candidat PDCI. Les deux hommes, dont la dernière rencontre remonte à février 2024, sont en froid.
2. Mali : des dissensions au sein de la junte ?

Malick Diaw (à g.), Assimi Goïta (1er rang au c.), Sadio Camara (2e rang au c.) et Ismaël Wagué (à dr.), lors de la cérémonie de remise des attributs des nouveaux généraux de l’armée malienne, à Bamako, le 21 octobre 2024. © Présidence de la République du Mali
Deux camps. C’était leur point fort quand ils ont pris le pouvoir en 2020 : la cohésion. Mais les années ont passé et désormais, les colonels maliens devenus généraux semblent de plus en plus divisés. Fatoumata Diallo et Matteo Maillard racontent comment la montée en puissance du président de la transition Assimi Goïta a créé deux camps au sein du pouvoir : le sien et celui de Sadio Camara, ministre de la Défense.
Légitimité. « Les militaires qui dirigent le pays ne sont plus sur la même ligne, explique un officier malien à la retraite. Il existe des divergences prononcées sur la suite à donner à la transition. Il ne fait plus de doute qu’Assimi Goïta souhaite se maintenir au pouvoir en passant par une élection qui lui donnerait un vernis de respectabilité. Le problème, c’est que Sadio Camara et Malick Diaw ne souhaitent pas suivre l’agenda de celui qu’ils ont élu il y a quatre ans. »
Selon Sadio Camara, son cadet « n’a pas la légitimité » pour le poste. Goïta, lui, a cessé de consulter celui qui était considéré comme le « cerveau » du coup d’État. La junte y survivra-t-elle ?
3. Le souverainisme économique au banc d’essai

La mine d’or de Syama explooitée par Resolute Gold au Mali, en 2019. © Philip Mostert/Resolute Gold
Nouvelle vague. Prise de distance avec l’Occident, réappropriation des ressources naturelles, émancipation monétaire et institutionnelle… Une nouvelle vague d’indépendance déferle sur l’Afrique de l’Ouest et ses conséquences économiques s’annoncent durables. Comment s’exprime-t-elle ? Que faut-il en penser ? Jeune Afrique fait le point avec trois articles publiés cette semaine.
Stratégie risquée. « Le souverainisme est une stratégie payante à court terme », explique Tristan Guéret, analyste senior chez Control Risks. Par exemple, au Mali, les recettes provenant des mines d’or auraient augmenté de 52,5 % l’année dernière, avec 835,1 milliards de F CFA (1,27 milliard d’euros) en 2024, selon un document du ministère des Mines consulté par Reuters début avril. Mais à long terme, la stratégie est peut-être bien plus risquée, avec la crainte d’un désengagement des investisseurs privés. Or, « les opérateurs locaux n’ont pas forcément, à l’heure actuelle, les moyens de s’impliquer dans des mines d’envergure », poursuit l’analyste.
Notre série de trois articles revient également sur les difficultés sénégalaises face à la dette contractée les années précédentes. Si Bassirou Diomaye Faye était tenté de faire l’impasse sur le remboursement, qu’adviendrait-il ? D’autres pays ont essayé, ça ne s’est pas forcément bien passé.
4. Climat : des solutions africaines pour gagner la bataille de l’adaptation

© Marie Toulemonde
Le constat. L’Afrique est responsable de 4 % des émissions de gaz à effets de serre. Pourtant, c’est le continent sur lequel les populations paient le plus lourd tribut aux conséquences du dérèglement climatique. Les évènements météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, inondations, etc.) s’y multiplient de manière exponentielle, frappant des économies déjà fragiles. Dans le même temps, les pays dits développés tardent à remplir leurs promesses, et les financements tardent pour accélérer la transition énergétique et mettre en place les mesures d’adaptation les plus urgentes.
Les solutions. L’espoir est néanmoins là. En attendant l’improbable remboursement de la « dette climatique » contractée par les pays du Nord envers le Sud global, et l’Afrique en particulier, des militants, acteurs publics et entrepreneurs africains déploient des trésors d’inventivité pour développer des solutions pour faire face, sur les multiples fronts ouverts par la crise climatique.
Ici, on développe des systèmes de refroidissements grâce à l’énergie solaire. Là, ce sont les plantes invasives qui sont transformées en ressources écologiquement durables. Ailleurs, certains tentent de repenser la ville pour limiter les impacts sanitaires des hausses de températures. Et de Dakar à Djibouti, le long du tracé de la « Grande muraille verte » qui tarde à avancer réellement, les initiatives locales se multiplient pour tenter de freiner la désertification.
Ce sont ces solutions africaines à des enjeux africains, que nous vous proposons de découvrir dans notre série d’infographies en quatre volets. Un dossier réalisé en amont du sommet Change Now, dont Jeune Afrique est partenaire.
5. La stratégie des « brouteurs » décryptée

Le cyberescroc Ramon Abass, alias “Ray Hushpuppi”. © INSTAGRAM HUSHPUPPI
Phénomène. Leur gagne-pain, c’est l’arnaque bon marché. Les « brouteurs » sont des escrocs en ligne, aujourd’hui à la tête d’une industrie informelle, dont le chiffre d’affaires annuel mondial se compte en centaines de millions d’euros. Jeune Afrique a décidé de consacrer une série d’enquêtes à ce phénomène implantée en Afrique de l’Ouest :
- Mehdi Ba retrace ainsi l’histoire et les stratégies de l’ « arnaque à la nigériane » née au début du XXe siècle avant d’essaimer dans les pays voisins. Basée sur une conversation à distance, par écrit, entre le « brouteur » et son « mougou » (le pigeon), le plus souvent un homme ou une femme de plus de 50 ans résidant en Europe de l’Ouest.
- Eniola Akinkuotu dresse les portraits de célèbres cybercriminels nigérians, comme Hushpuppi, Mompha ou Sabbie, qui ont tous gagné des millions d’euros avec leurs activités.
- Mawunyo Hermann Boko s’est lui laissé piéger volontairement par un arnaqueur, pour mieux comprendre les procédés utilisés. Le faux Emmanuel Adebayor, ancien joueur de football togolais, utilise une tactique rodée, le « bara star » et demande une avance de 500 euros avant de promettre d’envoyer en retour 3 800 euros.
- Mehdi Ba raconte aussi l’action des chasseurs de brouteurs : des agents d’Interpol, mais aussi des hackeurs éthiques.