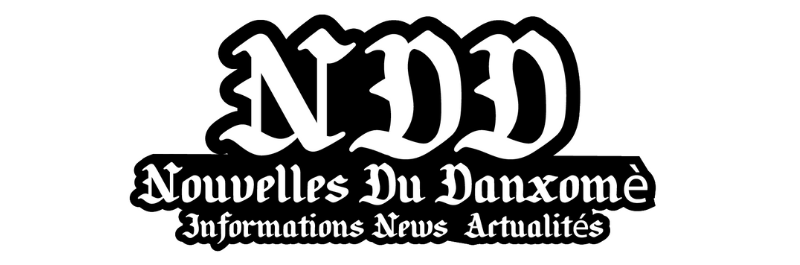L’iroko ou le Milicia excelsa fait partie des espèces autochtones qui retiennent l’attention, à la 38e édition de la journée nationale de l’Arbre. C’est un arbre sacré, mais qui a besoin encore plus de protection.
« Adieu l’Iroko ? » Ce n’est pas le moment de chanter le requiem de l’arbre fétiche. Mais, ce n’est non plus le moment de baisser les bras puisqu’il s’agit d’un « taxon en danger ». En réalité, avec le système de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories.
La classification dans l’une des catégories d’espèces menacées (En danger critique, En danger, Vulnérable) s’effectue par le biais de critères basés sur des facteurs associés au risque d’extinction. C’est-à-dire la taille de population, le taux de déclin, l’aire de répartition géographique, le degré de peuplement et de fragmentation de la répartition. « Lorsqu’on observe l’iroko dans son aire de répartition, chez nous au Bénin, on le classe comme espèce déjà en danger.
Elle a quitté le premier niveau de menace qui est Vulnérable pour le second », explique le colonel Simon Awokou, directeur du reboisement et de l’aménagement des forêts. Les espèces en danger sont celles dont la population est réduite de 70 à 50 %, ou ayant une zone d’occupation en dessous de 5000 km2 et la sous-population de l’espèce n’occupe pas plus de 500 km2 ou encore que la population soit estimée à moins de 250 individus matures.
Victime d’une mauvaise réputation
Si l’iroko est en danger, c’est bien l’humain qui en est le responsable, lui qui déboise tout sur son passage. Pendant longtemps, voire jusqu’à maintenant, le Milicia excelsa est souvent considéré comme l’arbre qui abrite les mauvais esprits. « Les gros arbres en général, l’iroko en particulier, ont été taxés d’espèces abritant des sorciers. Dans la chasse aux sorciers, il fallait couper tous ces arbres. C’est ce qui a fait qu’une bonne partie des individus ont été abattus. Cela a drastiquement baissé la population de l’espèce», souligne-t-il.
Cependant, il n’y a pas que ces pesanteurs socioculturelles qui menacent l’espèce. La surexploitation des ressources forestières en est pour beaucoup. « Milicia excelsa fournit du bon bois d’œuvre très apprécié par les menuisiers enquêtés. Mais les madriers de l’iroko sont actuellement rares à cause de la rareté des individus à grand diamètre et de la coupe frauduleuse des sujets à faible diamètre (7,1 % de menuisiers seulement continuent de travailler le bois d’iroko) », faisait remarquer une étude sur les stratégies de gestion de l’iroko (Milicia Excelsa) dans l’aire culturelle Vodun au Bénin. « Il faut reconnaître que c’est une espèce de bois d’œuvre qui a été beaucoup utilisée avant que les gens ne découvrent les autres essences. La recherche du bois d’œuvre a été donc aussi une menace importante », ajoute le colonel Simon Awokou.
Bien aimé aussi !
L’iroko atteint une hauteur maximale de 50 m pour un diamètre de l’ordre de 2,5 m. L’écorce a une teinte allant du gris au brun foncé et présente des lenticelles jaunâtres. Le tronc cylindrique et généralement droit est dépourvu de branches sur une hauteur de 15 à 30 m. L’espèce n’a pas mauvaise réputation auprès de tout le monde. Elle est souvent utilisée dans la médecine traditionnelle. C’est aussi un arbre sacré, vénéré et protégé par le système traditionnel. Il est considéré comme la première espèce déifiée au Bénin, suivi du baobab. Le pourcentage d’adoration variait entre 29,2 % et 53,1 % selon les départements.
« On constate que dans nos villages, c’est au pied de l’iroko que beaucoup de cérémonies de sacrifices se font. On voit que la plupart de ces irokos sont recouverts d’un linge blanc, signe de leur sacralité», fait remarquer Simon Awokou. Beaucoup de scientifiques s’intéressent à son potentiel de séquestration de carbone. Il pourrait jouer un rôle primordial dans l’atténuation des effets du changement climatique. Il y a lieu de travailler pour sa conservation. L’une des pistes pourrait être de le ramener dans les domaines classés de l’État, pour en faire pourquoi pas des plantations.