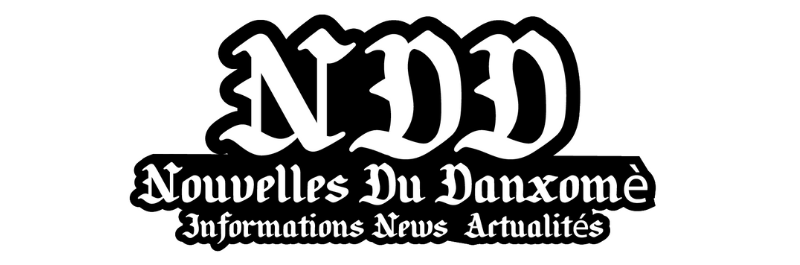Installation des populations dans les marécages et autres zones humides, défaut d’application de l’arrêté interdisant l’occupation des zones inondables… À Cotonou, l’urbanisation incontrôlée a donné lieu à une ville exposée aux dégâts climatiques nécessitant des dizaines de milliards de F Cfa pour envisager la résilience.
Un semestre vient de s’écouler, mais Vossa, un quartier de plus de 6 000 habitants situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, porte encore les stigmates de la crue d’octobre 2022 du lac
Nokoué. « C’était trop. Les eaux ont atteint une hauteur qu’on ne pouvait pas imaginer », confie Jude
Salomon Houetchekpo, président de l’Association de développement de ce quartier situé aux abords du lac Nokoué, le plus grand plan d’eau du Bénin.
Dans sa chambre, tout est surélevé. Une précaution pour éviter d’être électrocuté. « J’ai dû poser mes installations électriques sur des briques de 15 cm chacune. Les trois premiers niveaux ont été noyés. C’est le quatrième qui nous a mis à l’abri », poursuit Jude.
Le lac est sorti de son lit pour réclamer un peu plus de droits sur les espaces environnants. Ses caprices ont duré deux interminables mois, pour les habitants de Vossa. Jude ainsi que les nombreux sinistrés, sont restés sur place, les pieds dans l’eau, et pour certains, dans des habitations précaires, avec des toitures dégradées.
« Nous sommes restés par peur que les gens viennent défoncer les portes et voler nos biens. Moi, à un moment donné, j’ai dû envoyer les enfants et mon épouse rester à un autre endroit», justifie Jude, pour qui le lac se rapproche d’année en année. « Avant, nous étions à deux, voire trois kilomètres de la rive. Maintenant, ça n’atteint pas un kilomètre. Plusieurs habitations ont déjà été ravagées », martèle-t-il.
En réalité, dans les quartiers périphériques du lac Nokoué, les inondations ne sont pas seulement causées par les pluies qui s’abattent sur Cotonou, mais aussi par les crues du fleuve Ouémé.
Pierre Vennetier, directeur de recherche honoraire du Centre national de la Recherche scientifique (Cnrs), dans une contribution scientifique avant-gardiste publiée dans la revue Les Cahiers d’Outre-Mer de 1991, sonnait l’alerte.
Le fleuve Ouémé, qui prend sa source aux pieds des monts de l’Atacora au nord du pays, ne connaît qu’une seule saison humide de juin à octobre. En raison de la pente du cours et de la nature des roches du bassin, l’onde se propage très rapidement et atteint le lac dès la mi-juillet.
« Cotonou connaît essentiellement des inondations par débordement du cours d’eau, en raison des eaux en provenance du nord. Lorsque le lac est trop plein, comme une bassine, il y a débordement. Nous avons réalisé des cartes pour modéliser, en fonction du niveau d’élévation, les parties de la ville qui sont susceptibles d’être immergées », précise Professeur Eric Tchibozo, secrétaire général de l’Institut géographique national du Bénin, par ailleurs, auteur de nombreux travaux cartographiques sur les zones humides.
Le pire est à craindre
Le changement climatique et ses conséquences ont mis à rude épreuve le système lagunaire de la région. La crue de 2022 a été particulièrement difficile à supporter pour le quartier Vossa. Germain Agbo, chef du quartier Vossa, se souvient que la dernière situation similaire à Vossa remonte à 12 ans « Beaucoup ont été tentés de quitter leur domicile. Pour ma part, j’ai choisi de rester. En tant que chef de quartier, je ne peux pas abandonner mes administrés », rappelle-t-il.
Les scénarios climatiques de référence retenus dans le Plan national d’adaptation du Bénin ne sont pas particulièrement rassurants ou sont-ils tout du moins alarmants. Dans l’édition de 2020, on peut y lire que « les hauteurs annuelles des précipitations accusent globalement une tendance à la baisse à l’horizon 2050 et une tendance à la hausse à l’horizon 2100 ».

Faute d’exutoires du fait de l’occupation des zones inondables…
Professeur Michel Boko, climatologue, Co-Prix Nobel de la Paix 2007, a dans une communication scientifique expliqué les scénarios. A l’en croire, soit les cours d’eau tributaires du lac perdent en débit et corrélativement, les inondations deviennent moins dangereuses, mais cela n’augmentera pas l’espace disponible pour l’extension de la ville.
Cependant, si le réchauffement climatique s’accentue avec l’élévation du niveau moyen de l’océan mondial, il y aura matière à craindre en plus. « Selon certaines projections, la ville de Cotonou en aurait encore pour 40 à 200 ans, selon les scénarios, avant d’être engloutie par une remontée des eaux souterraines dans les espaces interdunaires qui occupent 40 % de la superficie de la ville, mais aussi une accélération de l’érosion côtière et les intrusions salines », craint Professeur Boko.
Du béton dans les marécages
Dans ce contexte, la durabilité de la ville de Cotonou est mise en question. Les zones humides jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques climatiques. Selon la Convention
de Ramsar, dont le Bénin est signataire depuis le 24 mai 2000, les zones humides intérieures telles que les plaines d’inondation, les cours d’eau, les lacs et les marais agissent comme des éponges en absorbant et stockant les précipitations excessives, réduisant ainsi le risque d’inondation. « Ce sont des exutoires naturels pour l’eau pendant la saison des pluies », confirme le Professeur Tchibozo.
Cependant, la ville de Cotonou est déjà handicapée en matière de gestion des risques climatiques, notamment les scénarii d’inondation à grande échelle. Les lits du lac Nokoué, les bas-fonds, les marais et autres chenaux naturels, qui jouent le rôle naturel de zones éponges et qui devraient immuniser cette ville contre certains types d’inondation sont occupés, séquestrés par des constructions.
« Ce qu’on a perdu est très important. Il est évident pour tout le monde que les zones humides régressent au profit de l’urbanisation. C’est le moment de voir avec ce que nous vivons les conséquences de ce qui s’est fait depuis plusieurs années et comment arrêter », explique Professeur Tchibozo qui décrit la situation dans ce secteur de la ville, dans une étude publiée en 2013 sur la périurbanisation et la dégradation de l’espace littoral situé à l’ouest de l’aéroport de Cotonou.
Les résultats de ses recherches montrent une régression significative des marais (41,30 %), de l’eau (8,89 %) et des sols nus (37,33 %). Le taux d’occupation du sol par l’habitat dans cette zone avait déjà progressé de 36,29 % entre 1988 et 2006, et ce pourcentage n’est plus retombé depuis.
Dix ans après la publication de cette étude, le chercheur, approché sur la question, maintient cette tendance régressive des zones humides à Cotonou et ses environs.
Et sur cette question, la cartographie de l’occupation du sol dans la ville de Cotonou, au cours des 30 dernières années, est, on ne peut plus éloquente.
« On ne devrait pas lotir… »
L’urbanisation incontrôlée de Cotonou a été favorisée par les lacunes législatives, le défaut d’une politique urbaine efficace et les pratiques informelles.
Les autochtones, s’appuyant sur le droit coutumier, ont procédé à des morcellements de terre sans tenir compte des risques environnementaux. Le coût de la parcelle était abordable dans ces zones, d’où le flux massif des populations vers elles et leur occupation à un rythme effréné.
« Vossa n’est pas un quartier inondable. Je suis venu ici en 1971. C’est après la construction du nouveau pont de Cotonou que le débordement du lac a commencé. Ces parcelles, nous les avons payées chez les autochtones de la ville. Certains l’ont payée à 150 000 Fcfa, d’autres à 200 000 Fcfa », se défend Germain Agbo, chef du quartier Vossa, dans le 6e arrondissement.

…la restauration des exutoires occupés par les habitations demeure impérative
La Société de gestion immobilière (Sonagim), créée par l’État le 14 août 1978, n’a pas pu arrêter la saignée. Cette structure n’a d’ailleurs pas fait long feu. Le 7 février 1992, le tout premier ministre de l’Environnement du Bénin, Eustache Sarré, a pris un arrêté pour interdire l’occupation des zones impropres à l’habitation.
« Ce qui tenait lieu de municipalité faisait les lotissements et pérennisait l’installation des populations dans ces mêmes zones insalubres. Il n’y avait pas de mesures prises pour empêcher ces pratiques. On nous a dit qu’il y a une commission interministérielle qui se réunit depuis des années et qui n’a jamais fini ses travaux. Et donc aucun document administratif n’empêchait les populations de s’installer dans ces zones. Nous avons pris l’arrêté pour parer à l’urgence », confie l’ex-ministre, octogénaire.
Un décret prendrait, dit-il, du temps. Mais la mesure n’a pas pu freiner la pratique. « Les populations s’installent indûment et les chefs de district, pour se rendre populaires, lotissent ces zones en contradiction avec l’arrêté. « Le gouvernement est prémuni contre ces violations. Ceux qui ont agi, que ce soit les populations, les géomètres, les urbanistes étaient en mesure de s’opposer à cet état de fait. Si les gens ont continué à le faire, ce sont des motivations populistes contribuant aux misères des populations. On peut dire que cet arrêté a quand même permis de retenir l’administration dans cette pratique », fait-il remarquer.
L’ancien ministre regrette qu’il n’y ait pas eu de sanctions pour décourager ces pratiques et freiner l’occupation des zones inondables. « Le gouvernement n’a pas pris de sanctions. Ce qui aurait été intéressant, c’est d’informer les gens sur les dégâts, les pertes financières et sanitaires. Cela aurait dû être une action », ajoute-t-il. Il a surtout manqué des actions de délimitation de ces zones et de leur vulgarisation.
Un avis largement partagé par Professeur Tchibozo. « On aurait dû délimiter ces zones et les interdire à l’occupation. Lorsqu’il y a eu une première installation, on aurait dû déjà dégager ces zones interdites d’occupation. Il est vrai que ce n’était pas si facile, car il y avait encore du foncier disponible. Les gens achetaient partout, mais avec les dernières pluies, on a vu ce que Vossa est devenu. On ne devrait pas avoir loti Vossa, mais cela a été fait. C’est urbanisé », déplore-t-il.
Oser restaurer
Au Bénin, la facture des inondations est extrêmement salée. Les pertes et dommages des inondations de 2010 ont été évaluées à environ 48,8 milliards F Cfa. Les dommages et pertes de celles de 2019 pourraient être évalués à 53,29 milliards de francs Cfa, selon l’Agence nationale de Protection civile (Anpc). Face à ces dégâts et à la croissance des risques, le pays mobilise des investissements de taille pour une résilience.
Ces dernières années, des ressources importantes sont mobilisées pour la mise en œuvre du Programme d’Assainissement pluvial de Cotonou (Papc). D’un coût de réalisation estimé à 264 milliards F Cfa (434 499 384 dollars américains), ce projet, selon le gouvernement, viendra soulager les 34 bassins versants sur les 50 dont dispose la ville et qui ont montré leurs limites pour ce qui est de la capacité de drainage des eaux de pluie. Cotonou sera aussi dotée de 46 km de caniveaux et de grands collecteurs, ainsi que 90 km de caniveaux de taille moyenne.
Malgré les investissements en cours pour la gestion des eaux pluviales à Cotonou, la restauration des exutoires occupés par les habitations demeure impérative. « Le gouvernement fait beaucoup d’efforts pour préserver les zones inondables, mais cela ne suffit pas. Le phénomène d’occupation de ces zones a prospéré et entraîné d’autres habitants du Bénin à s’installer dans de telles zones. Les autorités doivent fournir un gros effort non seulement pour sanctionner, mais aussi pour informer et sensibiliser », insiste Eustache Sarré, qui espère que les populations prendront conscience de l’importance de ne pas occuper ces zones.
Avec la menace du changement climatique, des actions fortes sont nécessaires pour débarrasser les zones à risque, comme c’est le cas à Xwlacodji près du chenal de Cotonou. « Cela doit être fait progressivement au fur et à mesure des besoins. Un travail est en cours pour évaluer ces zones. L’action qui reste à mener est la sensibilisation, avec un peu de contrainte et de force pour débarrasser ces zones humides des occupations illicites. Le problème est que certaines de ces zones sont loties », explique le professeur Eric Tchibozo.
En excluant de saisir à bras-le-corps la question de l’occupation des zones humides, dans sa stratégie de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, le Bénin pourrait, à s’y méprendre, déployer des efforts certes colossaux, mais vains.
Cet article a été produit avec le soutien de Media Foundation for West Africa, la Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre de son programme de bourse sur le changement climatique.