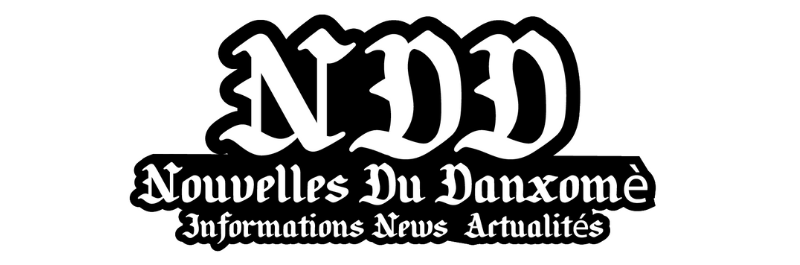Dans de nombreux pays africains, le secteur informel constitue une part essentielle de l’économie, représentant parfois jusqu’à 60 % du produit intérieur brut. Petits commerces, marchés de rue, services artisanaux : ces activités échappent souvent à toute réglementation, privant les États de ressources fiscales conséquentes. Bien que ce tissu économique parallèle soutienne des millions de ménages, il complique la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et freine le développement de systèmes financiers solides. La situation, bien connue à travers le continent, trouve un écho particulier au Maghreb, où certains gouvernements cherchent désormais à canaliser cette manne vers les circuits officiels.
Une ambition claire : intégrer 90 milliards de dollars dans le circuit officiel
En Algérie, l’économie informelle représente un enjeu majeur. Selon des estimations relayées par des experts locaux, près de 90 milliards de dollars circuleraient chaque année hors du système bancaire traditionnel. Pour tenter de capter ces flux, les autorités ont élaboré un plan visant à attirer progressivement les opérateurs économiques informels vers les structures financières formelles. Cette initiative repose sur une série de mesures pratiques destinées à réduire la distance entre les populations marginalisées et les services bancaires.
L’idée centrale est de rendre les banques plus accessibles, notamment pour les groupes souvent écartés du système traditionnel, tels que les personnes âgées, les habitants des zones rurales, les femmes en situation d’isolement économique ou encore les personnes en situation de handicap. La stratégie prévoit la simplification de l’ouverture de comptes bancaires et l’extension des moyens de paiement électroniques, afin de favoriser une transition en douceur vers la formalisation de l’activité économique.
Des solutions technologiques adaptées pour l’inclusion financière
L’un des leviers mis en avant concerne l’innovation technologique. Les banques algériennes sont encouragées à développer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des usagers vulnérables. Parmi les initiatives en cours figurent l’introduction de dispositifs de paiement intégrant le braille pour les malvoyants et de lecteurs vocaux pour les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles. L’objectif est clair : éliminer les obstacles matériels à l’accès aux services financiers.
Au-delà des outils, un effort particulier est déployé pour former les populations à l’utilisation des produits bancaires modernes. L’éducation financière devient un pilier essentiel pour accompagner cette transition, car sans compréhension suffisante des mécanismes bancaires, les initiatives risquent de rester lettre morte. Ce travail de fond, bien que long, apparaît indispensable pour établir une relation de confiance entre les acteurs informels et les institutions financières.
Vers une refonte progressive de l’économie nationale
L’intégration du secteur informel ne se limite pas à une simple question de collecte d’impôts. Elle conditionne également la capacité du pays à financer ses services publics, à améliorer ses infrastructures et à stabiliser sa croissance économique. Chaque dollar récupéré représente une contribution potentielle à l’amélioration des écoles, des hôpitaux ou des transports publics.
Dans ce contexte, l’approche algérienne rejoint une tendance observée dans plusieurs États africains qui cherchent à moderniser leur économie sans exclure ceux qui, jusqu’ici, en étaient restés en marge. La réussite de ce chantier pourrait non seulement renforcer la résilience économique du pays mais aussi inspirer d’autres gouvernements confrontés aux mêmes défis structurels.
L’intégration progressive des flux informels dans l’économie officielle s’annonce comme un processus délicat, nécessitant de conjuguer incitations, innovations et pédagogie. Si les résultats sont au rendez-vous, l’Algérie pourrait transformer une faiblesse chronique en levier de développement durable.